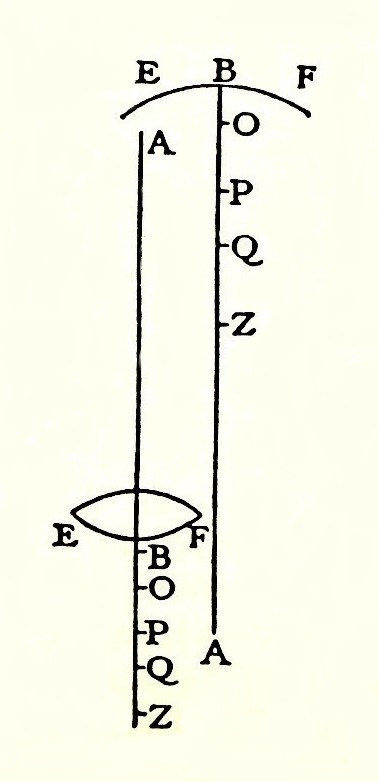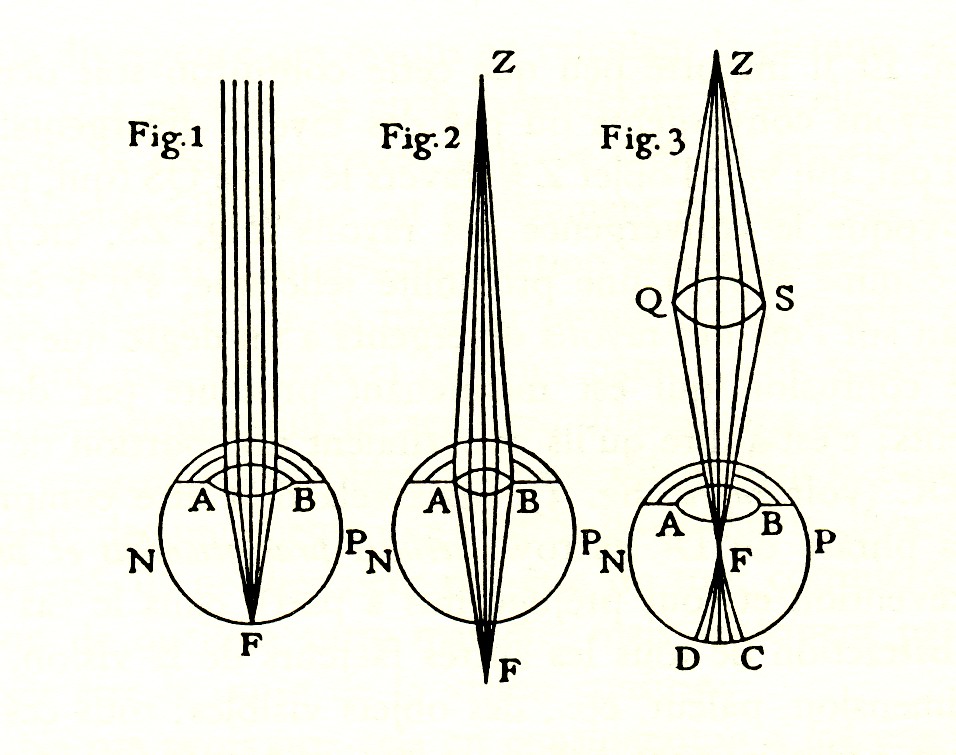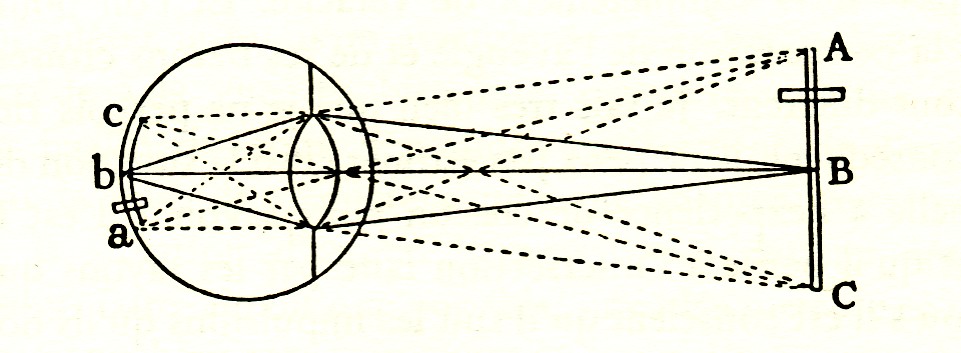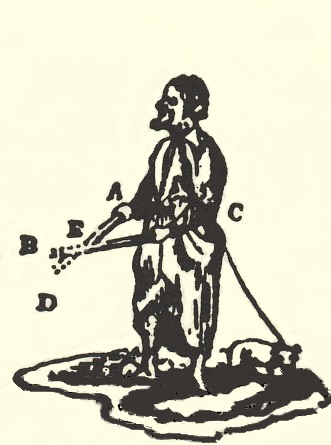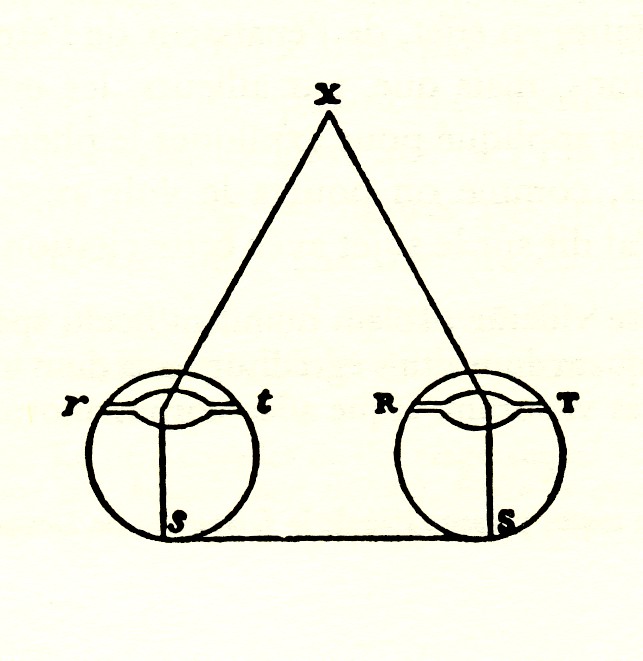|
|
|
|||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
George Berkeley
|
|||||||
|
Un essai pour une nouvelle théorie de la vision Imprimé en 1709 à Dublin (première édition). La deuxième édition, suivie d'un appendice, ne paraît probablement qu’au début de l’année 1710. L’Essai sera ensuite publié deux fois en 1732. |
|||||||
| Table des matières | |||||||
|
|
1 – Mon dessein est de montrer la manière dont nous percevons par la vue la distance, la grandeur et la situation des objets. C’est aussi de considérer la différence qu’il y a entre les idées de la vue et celles du toucher, et s’il y a quelque idée commune à ces deux sens. 2 – Tout le monde admet, je pense, que la distance ne peut être vue en elle-même et immédiatement. Car, étant une ligne dont l’extrémité est orientée vers l’œil, la distance ne projette, sur le fond de l’œil, qu’un seul point qui reste invariablement le même, que la distance soit plus longue ou plus courte. 3 – Je constate également ceci : il est reconnu que l’estimation que nous faisons de la distance des objets considérablement éloignés est plus un acte de jugement fondé sur l’expérience qu’un acte des sens. Lorsque je perçois, par exemple, un grand nombre d’objets intermédiaires, tels que des maisons, des champs, des rivières et autres choses semblables, que je sais, par expérience, occuper un espace considérable, je forme par là le jugement ou la conclusion que l’objet que je vois au-delà d’eux est à une grande distance. En outre, lorsqu’un objet apparaît pâle et petit, objet dont j’ai eu l’expérience de la forte et grande apparence à une proche distance, je conclus immédiatement qu’il est loin ; et c’est là manifestement le résultat de l’expérience sans laquelle je n’aurais, de la petitesse et de la pâleur, rien inféré concernant la distance des objets. 4 – Mais quand un objet est placé à une distance assez proche pour que l’intervalle entre les deux yeux soutienne avec elle une proportion sensible, l’opinion des théoriciens est que les deux axes optiques (la fiction selon laquelle nous ne verrions qu’avec un œil est rejetée) convergeant vers l’objet y font un angle, par le moyen duquel, selon qu’il est plus grand ou plus petit, l’objet est perçu comme plus proche ou plus éloigné (1). 5 – Entre cette manière d’estimer la distance et la manière précédente, il y a cette différence remarquable : alors qu’il n’y avait aucune connexion apparente et nécessaire entre une petite distance et une apparence grande et forte, ou entre une grande distance et une apparence petite et pâle, une connexion très nécessaire apparaît ici entre un angle obtus et une courte distance, et entre un angle aigu et une distance plus longue. Ce qui ne dépend pas du tout de l’expérience, puisque chacun peut savoir d’une manière évidente, avant d’en avoir eu l’expérience, que plus le point de concours des axes optiques est proche, plus l’angle sera grand, et plus le point de concours est éloigné, plus l’angle compris entre les axes sera petit. 6 – Les auteurs d’optique mentionnent une autre manière par laquelle ils veulent nous faire juger de ces distances pour lesquelles la largeur de la pupille a une grandeur appréciable : c’est la plus ou moins grande divergence des rayons qui, partant du point visible, tombent sur la pupille ; ce point étant jugé très proche s’il est vu par des rayons très divergents, et plus éloigné s’il est vu par des rayons moins divergents ; et ainsi de suite, la distance apparente augmentant toujours à mesure que la divergence des rayons décroît, jusqu’à, finalement, devenir infinie lorsque les rayons qui tombent sur la pupille sont sensiblement parallèles. Et c’est de cette manière, dit-on, que nous percevons la distance lorsque nous regardons avec un œil seulement. 7 – Dans ce cas aussi il est clair que nous ne devons rien à l’expérience ; car c’est une vérité certaine et nécessaire que plus les rayons directs qui tombent sur l’œil sont près d’atteindre le parallélisme, plus est éloigné leur point d’intersection, ou le point visible d’où ils émanent. 8 – Or, bien que les explications que l’on a données ici de la perception d’une courte distance par la vue soient reçues pour vraies, et, en conséquence, utilisées pour déterminer la place apparente des objets, elles semblent néanmoins très peu satisfaisantes, et cela pour les raisons suivantes. 9 – Il est évident que lorsque l’esprit ne perçoit pas une idée immédiatement et en elle-même, il doit le faire par le moyen de quelque autre idée. Ainsi, par exemple, les passions qui sont dans l’esprit d’autrui me sont invisibles en elles-mêmes. Je peux néanmoins les percevoir par la vue, et si ce n’est pas immédiatement, c’est du moins par la couleur qu’elles produisent sur sa physionomie. Nous voyons souvent la honte ou la peur dans l’expression d’un homme en percevant les changements de sa physionomie lorsqu’il rougit ou lorsqu’il pâlit. 10 – De plus, il est évident qu’aucune idée, si elle n’est pas elle-même perçue, ne peut être le moyen de percevoir une autre idée. Si je ne perçois pas, en elles-mêmes, la rougeur ou la pâleur du visage d’un homme, il est impossible que je perçoive, grâce à elles, les passions qui sont dans son esprit. 11 – Or, d’après la section 2, il est clair que la distance est imperceptible dans sa nature propre, et pourtant elle est perçue par la vue. Il reste donc qu’elle doit être donnée à la vue par le moyen de quelque autre idée qui est elle-même immédiatement perçue dans l’acte de la vision. 12 – Mais ces lignes et ces angles, par le moyen desquels certaines personnes prétendent expliquer la perception de la distance, ne sont eux-mêmes pas du tout perçus, et ceux qui sont incompétents en optique n’y pensent, en vérité, jamais. J’en appelle à l’expérience de chacun pour savoir si, à la vue d’un objet, nous calculons sa distance par la grandeur de l’angle formé par la rencontre des deux axes optiques ; ou si nous pensons jamais à la plus ou moins grande divergence des rayons qui arrivent d’un point à notre pupilles. Chacun est le meilleur juge de ce qu’il perçoit et de ce qu’il ne perçoit pas. En vain me dira-t-on que je perçois certaines lignes et certains angles qui introduisent dans mon esprit les diverses idées de distance, aussi longtemps que je ne suis pas moi-même conscient d’une telle chose. 13 – Dès lors, puisque ces angles et ces lignes ne sont pas eux-mêmes perçus par la vue, il suit de la section 10 que l’esprit ne juge pas, par eux, de la distance des objets. 14 – La vérité de cette assertion sera encore plus évidente à quiconque considère que ces lignes et ces angles n’ont aucune existence réelle dans la nature, car ils ne sont qu’une hypothèse formulée par les mathématiciens, hypothèse qu’ils ont introduite en optique afin de pouvoir traiter cette science d’une manière géométrique. 15 – La dernière raison que je donnerai pour rejeter cette doctrine est que, même si nous admettions l’existence réelle de ces angles optiques, etc., et s’il était possible à l’esprit de les percevoir, ces principes ne se trouveraient pas moins être insuffisants pour expliquer les phénomènes de distance, comme il sera montré ci-après. 16 – Or, comme il a déjà été montré que la distance est suggérée à l’esprit par la médiation de quelque autre idée qui est elle-même perçue dans l’acte de voir, il nous reste à rechercher quelles sont les idées ou sensations qui accompagnent la vision, auxquelles nous pouvons supposer les idées de distance associées, et par lesquelles ces dernières sont introduites dans l’esprit. Et premièrement, il est certain par expérience que, lorsque nous regardons un objet proche avec les deux yeux, nous modifions, selon qu’il s’approche ou qu’il s’éloigne de nous, la disposition de nos yeux, en diminuant ou en élargissant l’intervalle entre les pupilles. Cette disposition ou ce mouvement des yeux est accompagné d’une sensation qui me semble être, dans ce cas, celle qui introduit l’idée de plus ou moins grande distance dans l’esprit. 17 – Non qu’il y ait une connexion naturelle ou nécessaire entre la sensation que nous éprouvons par le mouvement des yeux et une plus ou moins grande distance, mais parce que l’esprit, par une expérience constante, a trouvé que les différentes sensations qui correspondent aux différentes dispositions des yeux sont respectivement accompagnées par un degré différent de distance dans l’objet, il s’est développé une connexion habituelle ou coutumière entre ces deux sortes d’idées ; à tel point que l’esprit ne perçoit pas plus tôt cette sensation — qui provient du mouvement différent qu’il imprime aux yeux afin d’amener les pupilles à être plus ou moins écartées — qu’il perçoit, du même coup, l’idée différente de distance qu’il avait l’habitude d’associer à cette sensation ; tout comme en entendant un certain son est immédiatement suggérée à l’entendement l’idée que la coutume lui a unie. 18 – Et je ne vois pas comment je pourrais facilement me tromper sur ce point. Je sais évidemment que la distance n’est pas perçue en elle-même, et qu’elle doit, par conséquent, être perçue au moyen de quelque autre idée qui est immédiatement perçue, et qui varie avec les différents degrés de distance. Je sais aussi que la sensation qui provient du mouvement des yeux est immédiatement perçue en elle-même, et que ses divers degrés sont associés aux différentes distances qui ne manquent jamais de les accompagner dans mon esprit lorsque je vois distinctement avec les deux yeux un objet dont la distance est si petite que, par rapport à elle, l’intervalle entre les deux yeux a une grandeur appréciable. 19 – Je sais qu’il y a une opinion reçue selon laquelle l’esprit perçoit, en modifiant la disposition des yeux, si l’angle des axes optiques ou les angles latéraux compris entre l’intervalle des yeux et les axes optiques deviennent plus grands ou plus petits ; et selon laquelle il juge que, conformément à une sorte de géométrie naturelle, leur point d’intersection est plus proche ou plus éloigné. Mais je suis convaincu par ma propre expérience que cela n’est pas vrai, puisque je ne suis pas conscient de faire un tel usage de la perception que j’ai du mouvement de mes yeux. Et pour moi, porter ces jugements et tirer ces conclusions sans savoir que je le fais me semble tout à fait incompréhensible. 20 – Il suit de tout cela que le jugement que nous portons sur la distance d’un objet vu avec les deux yeux est entièrement le résultat de l’expérience. Si nous n’avions pas constamment trouvé que certaines sensations, provenant des diverses dispositions des yeux, accompagnaient certains degrés de distance, nous n’en tirerions jamais ces jugements soudains concernant la distance des objets ; pas plus que nous ne prétendrions juger des pensées d’un homme par les mots qu’il prononce, et que nous n’aurions jamais entendus auparavant. 21 – Deuxièmement, un objet placé à une certaine distance de l’œil — distance avec laquelle la largeur de la pupille soutient une proportion appréciable — est vu confusément lorsqu’on l’approche ; et plus on l’approche, plus son apparence devient confuse. Et, puisque l’on constate qu’il en est toujours ainsi, il se forme dans l’esprit une connexion habituelle entre les divers degrés de confusion et de distance : la plus grande confusion impliquant toujours la plus petite distance et la plus petite confusion la plus grande distance de l’objet. 22 – Cette apparence confuse de l’objet semble donc être le moyen par lequel l’esprit juge de la distance, dans ces cas où les auteurs d’optique les plus reconnus veulent qu’il en juge par la différente divergence avec laquelle les rayons qui proviennent du point radiant tombent sur la pupille. Aucun homme, je crois, ne prétendra voir ou toucher ces angles imaginaires que les rayons sont censés former selon leurs diverses inclinaisons sur l’œil. Mais on ne peut pas s’empêcher de voir si l’objet apparaît plus ou moins confus. C’est donc une conséquence manifeste de ce qui a été démontré, que l’esprit utilise, au lieu d’une plus ou moins grande divergence des rayons, une plus ou moins grande confusion de l’apparence, pour déterminer ainsi la place apparente d’un objet. 23 – Et il n’est pas même utile de dire qu’il n’y a pas une connexion nécessaire entre une vision confuse et une grande ou une petite distance. Car je demande à tout un chacun quelle connexion nécessaire il voit entre la rougeur et la honte. Et cependant, à peine apercevra-t-il cette couleur poindre sur le visage d’autrui que lui vient à l’esprit l’idée de cette passion qui, a-t-on observé, l’accompagne. 24 – Ce qui semble avoir égaré les auteurs d’optique à ce sujet, c’est qu’ils s’imaginent que les hommes jugent de la distance comme ils jugent d’une conclusion en mathématiques ; or, entre cette dernière et les prémisses, il est en effet absolument obligatoire qu’il y ait une connexion apparente et nécessaire ; mais il en est tout autrement pour les jugements soudains que les hommes font sur la distance. Nous ne devons pas penser que les bêtes et les enfants, ou même les personnes adultes et raisonnables, chaque fois qu’ils perçoivent un objet s’approcher ou s’éloigner d’eux, le perçoivent en vertu de la géométrie et de la démonstration. 25 – Pour qu’une idée puisse en suggérer une autre, il suffira qu’on ait observé qu’elles vont ensemble, sans qu’il soit besoin de démontrer la nécessité de leur coexistence, ou même de savoir ce qui les fait coexister ainsi. Il y a, sur ce point, de nombreux exemples que personne ne peut ignorer. 26 – Ainsi, une plus grande confusion ayant été constamment accompagnée par une distance plus courte, la première idée n’est pas plus tôt perçue qu’elle suggère la seconde à nos pensées. Et si le cours ordinaire de la Nature avait été que plus un objet est placé loin, plus il serait apparu confus, il est certain que la même perception qui, maintenant, nous fait penser qu’un objet approche nous aurait alors fait imaginer qu’il s’éloigne. Car cette perception, abstraction faite de l’habitude et de l’expérience, est également apte à produire l’idée d’une grande distance, d’une petite distance ou d’aucune distance. 27 – Troisièmement, lorsqu’un objet est placé à la distance ci-dessus spécifiée, et qu’on l’approche de l’œil, nous pouvons tout de même empêcher, du moins pour un moment, les apparences de devenir plus confuses en contractant l’œil. Dans ce cas, cette sensation tient lieu de vision confuse, en aidant l’esprit à juger de la distance de l’objet ; car celui-ci est estimé d’autant plus près que l’effort ou la contraction de l’œil qui rend la vision distincte est plus grand. 28 – J’ai exposé ici ces sensations ou idées qui semblent être les occasions générales et constantes introduisant dans l’esprit les différentes idées de proche distance. Il est vrai que, dans la plupart des cas, divers autres facteurs contribuent à former notre idée de distance, à savoir le nombre particulier, la dimension, le genre des choses vues, etc. A leur sujet, comme au sujet de tous les autres facteurs que j’ai mentionnés précédemment, et qui suggèrent la distance, j’observerai seulement qu’aucun d’entre eux n’a, dans sa nature propre, de relation ou de connexion avec la distance ; et qu’il n’est pas possible qu’ils puissent jamais en signifier les différents degrés autrement que parce que l’on a trouvé par expérience qu’ils leur sont associés. 29 – Je procéderai d’après ces principes pour rendre compte d’un phénomène qui a, jusqu’ici, étrangement embarrassé ceux qui ont écrit sur l’optique, et qui, loin d’avoir été expliqué, est de leur propre aveu manifestement incompatible avec toutes leurs théories de la vision ; par conséquent, si rien d’autre ne pouvait être objecté, ce phénomène serait à lui seul suffisant pour mettre leur crédit en question. Je vais vous présenter toute la difficulté dans les termes avec lesquels le savant Dr Barrow conclut ses leçons sur l’optique. |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
En français comme suit :
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
30 – Le principe ancien et communément reçu que le Dr Barrow mentionne ici comme le fondement principal de la Catoptrique de Tacquet est que « chaque point visible, vu par réflexion dans un miroir, apparaîtra placé à l’intersection du rayon réfléchi et de la perpendiculaire d’incidence ». Dans le cas présent, le fait que cette intersection est située derrière l’œil ébranle fortement l’autorité de ce principe selon lequel l’auteur mentionné ci-dessus procède tout au long de sa Catoptrique en déterminant la place apparente des objets vus par réflexion dans toute sorte de miroirs. 31 – Voyons maintenant comment ce phénomène s’accorde avec nos principes. Dans les figures précédentes, plus l’œil est placé près du point B, plus l’apparence de l’objet est distincte ; mais à mesure qu’il recule vers O, l’apparence devient plus confuse ; et en P, il voit l’objet encore plus confusément ; et ainsi de suite, jusqu’à ce que l’œil, qui est ramené en Z, voie l’objet dans la plus grande confusion. Par conséquent, d’après la section 21, l’objet devrait sembler s’approcher de l’œil graduellement à mesure qu’il s’éloigne du point B, c’est-à-dire qu’en O il devrait (en conséquence du principe que j’ai établi dans la section susdite) sembler plus proche qu’il ne l’était en B, et plus proche en P qu’en O, et plus proche en Q qu’en P ; et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il s’évanouisse complètement en Z. Et c’est exactement ce qui se passe, comme chacun peut, s’il le veut, facilement s’en assurer lui-même par l’expérience. 32 – Ce cas est, pour beaucoup, le même que celui où nous imaginerions un Anglais rencontrant un étranger qui utilise les mêmes mots qu’en anglais, mais avec une signification directement contraire. L’Anglais ne manquerait pas de porter un jugement erroné sur les idées attachées à ces sons dans l’esprit de celui qui les a utilisés. De même, dans le cas présent, l’objet parle (si je puis dire) avec des mots dont l’œil a une bonne connaissance, à savoir les confusions de l’apparence ; mais là où, jusqu’ici, des confusions plus grandes avaient toujours l’habitude de signifier des distances plus proches, elles ont, dans ce cas, une signification directement contraire, car elles sont associées avec des distances plus grandes. D’où il suit que l’œil doit être inévitablement trompé, puisqu’il prendra les confusions dans le sens où il a été habitué à le faire, et qui est directement opposé au vrai sens. 33 – Ce phénomène, dans la mesure où il bouleverse entièrement l’opinion de ceux qui veulent nous faire juger de la distance par des lignes et des angles — supposition dans laquelle il devient tout à fait inexplicable — ne me semble pas être ainsi une mince confirmation de la vérité de ce principe par lequel il est expliqué. Mais en vue d’une explication plus complète de ce point, et pour montrer jusqu’où l’hypothèse selon laquelle l’esprit juge d’après la différence de divergence des rayons peut être utile pour déterminer la place apparente d’un objet, il sera nécessaire de donner comme prémisse certains points qui sont déjà bien connus de ceux qui ont quelque compétence en dioptrique. 34 – Premièrement, tout point radiant est vu distinctement lorsque les rayons qui en proviennent sont, par le pouvoir de réfraction du cristallin, exactement réunis sur la rétine ou fond de l’œil ; mais s’ils sont réunis, soit avant d’arriver sur la rétine, soit après l’avoir dépassée, il y a, alors, vision confuse. 35 – Deuxièmement, supposons que, dans les figures ci-contre, NP représente un œi1 de conformation normale et conservant sa figure naturelle. Dans la figure 1, les rayons qui tombent d’une manière quasi parallèle sur 1’œi1 sont réfractés par le cristallin AB, de telle sorte que leur foyer, ou point d’union, tombe exactement sur la rétine ; mais si les rayons tombent d’une manière sensiblement divergente sur l’œil, comme dans la figure 2, leur foyer se trouve alors au-delà de la rétine ; ou si les rayons sont rendus convergents par la lentille QS avant d’arriver à l’œil, comme dans la figure 3, leur foyer F se trouvera devant la rétine.
Dans ces deux derniers cas, il est évident, d’après la section précédente, que l’apparence du point Z est confuse. Et autant la convergence ou la divergence des rayons qui tombent sur la pupille est plus grande, autant leur point de réunion sera plus éloigné de la rétine, soit devant soit derrière elle, et par conséquent, le point Z apparaîtra d’autant plus confus. Et cela, soit dit en passant, peut nous montrer la différence qu’il y a entre une vision confuse et une vision faible. Une vision est confuse quand les rayons qui proviennent de chaque point distinct de l’objet ne sont pas exactement rassemblés en un point correspondant sur la rétine, mais y occupent quelque espace, si bien que les rayons des différents points se mêlent et se confondent. Cette vision s’oppose à une vision distincte, et s’applique aux objets proches. Une vision est faible lorsque, en raison de la distance de l’objet ou de l’épaisseur du milieu intermédiaire, peu de rayons parviennent de l’objet à l’œil. Cette vision s’oppose à une vision vive et claire, et s’applique aux objets éloignés. Mais reprenons. 36 – L’œil, ou (à dire vrai) l’esprit, qui ne perçoit que la confusion elle-même sans jamais considérer la cause d’où elle procède, attache constamment le même degré de distance au même degré de confusion. Et il importe peu que cette confusion soit occasionnée par des rayons convergents ou par des rayons divergents. D’où il suit que l’œil, qui voit l’objet Z à travers le verre QS (qui, par réfraction, provoque la convergence des rayons ZQ, ZS, etc.), devrait le juger comme étant à une proximité telle que, s’il y était placé, il émettrait sur l’œil des rayons divergents à un degré que produirait la même confusion qui est maintenant produite par des rayons convergents ; c’est-à-dire qu’ils couvriraient une portion de la rétine égale à DC (voir supra, fig. 3). Mais cela doit être compris (pour utiliser la phrase du Dr Barrow) seclusis praenotionibus et praejudiciis (toute prévention et tout préjugé mis à part), dans le cas où nous faisons abstraction de tous les autres facteurs de la vision, tels que figure, dimension, pâleur, etc., des objets visibles ; tous ces facteurs concourent ordinairement à former notre idée de la distance, car notre esprit, par une expérience répétée, a observé que leurs différentes sortes, ou différents degrés, sont associés avec des distances variées. 37 – Il suit clairement de ce qui a été dit qu’une personne parfaitement myope (c’est-à-dire qui ne pourrait voir un objet distinctement que lorsqu’il est placé près de ses yeux) ne porterait pas le même jugement erroné que portent les autres dans le cas susmentionné. Car, pour elle, de plus grandes confusions suggérant constamment de plus grandes distances, elle doit, alors qu’elle s’éloigne du verre et que l’objet devient plus confus, juger que ce dernier est à une distance plus éloignée, contrairement à ce que jugent ceux pour qui une augmentation de confusion dans la perception des objets a été associée à l’idée de leur rapprochement. 38 – Par suite, il apparaît aussi qu’il peut y avoir une bonne utilisation du calcul par lignes et angles en optique ; non que l’esprit juge de la distance immédiatement par eux, mais parce qu’il en juge par quelque chose qui leur est associé, et à la détermination de quoi ils peuvent être utiles. Ainsi, l’esprit jugeant de la distance d’un objet par la confusion de son apparence, et cette confusion étant plus ou moins grande à l’œil nu selon que l’objet est vu par des rayons plus ou moins divergents, il s’ensuit qu’un homme peut faire usage de la divergence des rayons en calculant la distance apparente, encore que cela ne soit pas en la considérant pour elle-même, mais en raison de la confusion avec laquelle elle est associée. Mais, en fait, la confusion elle-même est entièrement négligée par les mathématiciens, comme n’ayant aucune relation nécessaire avec la distance, alors qu’ils estiment que de plus ou moins grands angles de divergence en ont une. Et ceux-ci (surtout parce qu’ils ressortissent au calcul mathématique) sont les seuls considérés dans la détermination des places apparentes des objets, comme s’ils étaient la cause unique et immédiate des jugements que l’esprit porte sur la distance. Alors que, en vérité, ils ne devraient pas être du tout considérés en eux-mêmes, ou de quelque autre manière, mais seulement parce qu’ils sont censés être la cause de la vision confuse. 39 – Ne pas avoir pris cela en considération a été une omission fondamentale et embarrassante. Pour preuve, il n’est pas besoin d’aller plus loin que le cas qui nous occupe. Comme on a observé que les rayons les plus divergents introduisaient dans l’esprit l’idée de la plus proche distance, et qu’en outre la divergence décroissait à mesure que la distance augmentait, et comme on a pensé que la connexion entre les divers degrés de divergence et la distance était immédiate, on est conduit naturellement à conclure, de par une analogie mal fondée, que les rayons convergents feront apparaître un objet à une immense distance, et que, à mesure que la convergence augmente, la distance (si cela était possible) devrait faire de même. Que cela fût la cause de l’erreur du Dr Barrow, c’est évident d’après ses propres termes, que nous avons cités. Mais le savant docteur eût-il observé que des rayons divergents et convergents, si opposés qu’ils puissent sembler, s’accordent néanmoins en produisant le même effet, à savoir une confusion de la vision, confusion dont les plus grands degrés sont produits indifféremment à mesure que soit la divergence soit la convergence des rayons augmente — et c’est par cet effet, qui est le même dans les deux cas, que soit la divergence soit la convergence est perçue par l’œil — eût-il, dis-je, considéré simplement cela, qu’il aurait certainement porté le jugement tout à fait contraire, et correctement conclu que ces rayons qui tombent sur l’œil avec de plus grands degrés de convergence devraient faire apparaître l’objet dont ils procèdent comme d’autant plus rapproché. Mais il est clair qu’il était impossible d’arriver à une vue exacte sur ce sujet tant qu’on n’avait d’attention que pour les lignes et les angles, et que l’on ne comprenait pas quelle est la vraie nature de la vision, et combien elle est éloignée des considérations mathématiques. 40 – Avant d’abandonner ce sujet, il convient de tenir compte d’une question qui s’y rapporte, et que propose l’ingénieux M. Molyneux dans son Traité de dioptrique (2) où, traitant de cette difficulté, il écrit ces mots : « Et ainsi, il (c’est-à-dire le Dr Barrow) laisse aux autres le soin de résoudre cette difficulté, ce que (après un si grand exemple) je ferai aussi ; mais, comme cet admirable auteur, je suis résolu à ne pas renoncer à la doctrine évidente que nous avons établie précédemment pour déterminer le lieu de l’objet (locus objecti), sous prétexte d’être gêné par une difficulté qui semble inexplicable tant qu’une connaissance plus poussée de la faculté visuelle ne sera pas atteinte par les mortels. Entre-temps, je propose à la réflexion des subtils la question de savoir si le lieu apparent (locus apparens) d’un objet, placé comme il est dit dans cette section 9, n’est pas autant devant l’œil que l’est, derrière l’œil, la base distincte. » A cette question nous pouvons oser répondre par la négative. Car, dans le cas présent, la règle qui détermine la distance de la base distincte, ou foyer respectif, à la lentille, est celle-ci : la différence entre la distance de l’objet et celle du foyer est au foyer, ou longueur focale, ce que la distance de l’objet au verre optique est à la distance du foyer respectif, ou base distincte, au verre optique (3). Supposons maintenant que l’objet soit placé, par rapport au verre optique, à la distance d’une fois et demie la longueur focale, et que l’œil soit tout près du verre, il s’ensuivra, d’après la règle, que la distance de la base distincte derrière l’œil est le double de la vraie distance de l’objet devant l’œil. Si donc la conjecture de M. Molyneux tenait bon, il s’ensuivrait que l’œil devrait voir l’objet deux fois plus loin qu’il ne l’est vraiment ; et, dans d’autres cas, à trois ou quatre fois sa vraie distance, ou plus. Mais cela contredit manifestement l’expérience, car l’objet n’apparaît jamais, au plus loin, au-delà de sa vraie distance. Tout ce qui est, dès lors, construit sur cette supposition s’écroule avec elle (voir corol. I, Prop. 57, ibid.). 41 – C’est une conséquence manifeste de tout ce qui a été dit auparavant qu’un aveugle-né, qui accéderait à la vue, n’aurait d’abord aucune idée de distance par la vue ; le soleil et les étoiles, les choses les plus éloignées comme les plus proches lui sembleraient toutes être dans son œil, ou plutôt dans son esprit. Les objets introduits par la vue lui sembleraient (ce qu’ils sont en vérité) n’être rien d’autre qu’un nouvel ensemble de pensées ou de sensations, dont chacune est aussi proche de lui que les sensations de peine ou de plaisir, ou que les passions les plus intérieures de son âme. Car lorsque nous jugeons que les objets perçus par la vue sont à quelque distance, ou hors de l’esprit, c’est (voir section 28) entièrement l’effet de l’expérience, qu’une personne, dans les circonstances indiquées, n’aurait pu encore acquérir. 42 – Il en est certes autrement selon la supposition commune, à savoir que les hommes jugent de la distance par l’angle des axes optiques, tout comme une personne qui est dans l’obscurité ou un aveugle en juge par l’angle compris entre deux bâtons qu’il tient chacun dans une main. Car, si cela était vrai, il s’ensuivrait qu’un aveugle-né qui a accédé à la vue n’aurait besoin d’aucune expérience nouvelle afin de percevoir la distance par la vue. Mais je pense que l’on a suffisamment montré que cela est faux. 43 – Et, après une recherche rigoureuse, nous trouverons peut-être que même ceux qui ont grandi, depuis leur naissance, dans l’usage habituel et ininterrompu de la vision n’ont pas irrévocablement versé dans le préjugé inverse, c’est-à-dire penser que ce qu’ils voient est à quelque distance d’eux. Car il semble, actuellement, y avoir plein accord, entre ceux qui ont réfléchi quelque peu à ce sujet, sur le fait que les couleurs, objet propre et immédiat de la vision, ne sont pas hors de l’esprit. Mais on dira, alors, que nous avons, par la vue, les idées d’étendue, de figure et de mouvement, toutes choses qui peuvent bien être pensées extérieures à l’esprit et à quelque distance de lui, alors que la couleur ne le devrait pas. Pour répondre à cela, j’en appelle à l’expérience de chacun afin de savoir si l’étendue visible d’un objet ne nous apparaît pas aussi proche que la couleur de cet objet ; bien plus, si elles ne semblent pas être toutes deux à la même place. L’étendue que nous voyons n’est-elle pas colorée, et nous est-il possible, même par la pensée, de séparer et d’abstraire la couleur de l’étendue ? Maintenant, là où est l’étendue, là se trouve sûrement la figure, et là aussi se trouve le mouvement. Je parle de ces idées qui sont perçues par la vue. 44 – Mais pour expliquer plus complètement ce point, et pour montrer que les objets immédiats de la vue ne sont pas comme les idées ou ressemblances des choses placées à distance, il est nécessaire que nous examinions de plus près ce sujet, et que nous observions soigneusement ce que l’on entend dans le langage courant lorsque l’on dit que ce que l’on voit est à quelque distance de soi. Supposons, par exemple, qu’en regardant la lune, je dise qu’elle est distante de moi de cinquante ou soixante rayons terrestres. Voyons de quelle lune il est question : il est clair que ce ne peut être la lune visible, ou aucune chose semblable ni à la lune visible ni à ce que je vois qui est seulement un plan rond et lumineux d’environ trente points visibles de diamètre. Car, au cas où je serais transporté directement du lieu où je me tiens vers la lune, il est manifeste que l’objet variera à mesure que j’avance ; et le temps que je me sois avancé de cinquante ou soixante rayons terrestres, je serai si loin d’être auprès d’un objet plat, petit, rond et lumineux que je ne percevrais rien de tel, car cet objet aura disparu depuis longtemps, et, si je voulais le retrouver, il faudrait que je retourne jusqu’à la terre d’où j’étais parti. Ou encore, supposons que je perçoive, par la vue, l’idée pâle et obscure de quelque chose dont je doute si c’est un homme, un arbre ou une tour, mais que je juge être à une distance d’environ un mille. Il est clair que je ne peux pas vouloir dire que ce que je vois est distant d’un mille, ou que c’est l’image ou la ressemblance de quelque chose qui est distant d’un mille, puisque, à chaque pas fait dans cette direction, l’apparence se modifie, et, d’obscure, petite et pâle qu’elle était, devient claire, grande et vive. Et lorsque j’arrive à la fin du mille, ce que je voyais d’abord a complètement disparu, et je ne trouve rien non plus qui lui ressemble. 45 – La vérité de ces exemples, et d’autres du même genre, se présente ainsi : ayant fait, depuis longtemps, l’expérience que certaines idées perceptibles par le toucher, telles que la distance, la figure tangible et la solidité, ont été associées avec certaines idées de la vue, je conclus aussitôt, à la perception de ces idées de la vue, que les idées tangibles, par le cours habituel et ordinaire de la nature, vont vraisemblablement suivre. En regardant un objet, je perçois une certaine figure et une certaine couleur, avec un certain degré de pâleur et d’autres facteurs, qui, d’après ce que j’ai observé antérieurement, me déterminent à penser que si j’avance de tant de pas, ou de tant de milles, je serai affecté par telles et telles idées du toucher : de sorte que, en vérité et strictement parlant, je ne vois ni la distance elle-même ni rien que je saisisse comme étant à distance. Je dis que ni la distance ni les choses placées à distance ne sont elles-mêmes, ou leurs idées, vraiment perçues par la vue. J’en suis persuadé, en ce qui me concerne ; et je crois que quiconque regardera minutieusement dans ses propres pensées et examinera ce qu’il entend en disant qu’il voit cette chose-ci ou cette chose-là à distance, conviendra avec moi que ce qu’il voit suggère seulement à son entendement ceci, à savoir qu’après avoir dépassé une certaine distance qui doit être mesurée par le mouvement de son corps, mouvement perceptible par le toucher, il arrivera à percevoir telles et telles idées tangibles qui ont été habituellement associées à telles et telles idées visibles. Mais que l’on puisse être trompé par ces suggestions des sens, et qu’il n’y ait aucune connexion nécessaire entre les idées visibles et les idées tangibles suggérées par elles, il n’est pas nécessaire, pour s’en convaincre, d’aller plus loin que le premier miroir ou le premier tableau venu. Remarquez que, lorsque je parle des idées tangibles, j’entends par le mot « idée » tout objet immédiat des sens ou de l’entendement — signification étendue dans laquelle les modernes emploient communément ce terme. 46 – Il suit manifestement de ce que nous avons montré que les idées d’espace, d’extériorité et de choses placées à distance ne sont pas, strictement parlant, les objets de la vue ; elles ne sont pas perçues autrement par l’œil que par l’oreille. Assis dans mon bureau, j’entends une voiture passer dans la rue ; je regarde à travers la croisée, et je la vois ; je sors et je monte dans la voiture ; ainsi, le langage courant nous amènerait à penser que j’entends, vois et touche la même chose, à savoir, la voiture. Il est néanmoins certain que les idées introduites par chacun des sens sont radicalement différentes et distinctes les unes des autres ; mais, comme on a observé constamment qu’elles vont ensemble, on en parle comme d’une seule et même chose. Je perçois, par la variation du bruit, les différentes distances de la voiture, et je sais qu’elle approche avant de regarder dehors. Ainsi, je perçois la distance par l’oreille exactement de la même manière que je la perçois par l’œil. 47 – Néanmoins, je ne dis pas que j’entends la distance de la même manière que je dis la voir, car les idées perçues par l’ouïe ne sont pas aussi propres à être confondues avec les idées du toucher que le sont celles de la vue. C’est ainsi, également, qu’une personne est facilement convaincue que les corps et les choses extérieures ne sont pas les objets propres de l’ouïe, mais que ce sont seulement les sons par l’intermédiaire desquels l’idée de ce corps-ci ou de ce corps-là, ou de la distance, est suggérée à ses pensées. En revanche, il est plus difficile d’amener quelqu’un à discerner la différence qu’il y a entre les idées de la vue et celles du toucher, bien qu’il soit certain qu’une personne ne voit pas la même chose qu’il sent, pas plus qu’il n’entend la même chose qu’il sent. 48 – Voici ce qui semble en être une des raisons. On pense que c’est une grande absurdité d’imaginer qu’une seule et même chose puisse avoir plus d’une étendue et plus d’une figure. Mais l’étendue et la figure d’un corps étant introduites dans l’esprit de deux manières, et cela indifféremment par la vue ou par le toucher, il semble s’ensuivre que nous voyons la même étendue et la même figure que l’étendue et la figure que nous sentons. 49 – Mais, si nous examinons avec exactitude la chose de près, nous sommes obligés de reconnaître que nous ne voyons et ne sentons jamais un seul et même objet. Ce qui est vu est une chose, et ce qui est senti en est une autre. Si la figure et l’étendue visibles ne sont pas les mêmes que la figure et l’étendue tangibles, nous n’avons pas à inférer qu’une seule et même chose a plusieurs étendues. La véritable conséquence consiste en ce que les objets de la vue et du toucher sont deux choses distinctes. Il peut se révéler nécessaire de réfléchir quelque peu pour bien concevoir cette distinction. Et la difficulté ne semble pas peu s’accroître parce que la combinaison des idées visibles a constamment le même nom que la combinaison des idées tangibles avec laquelle elle est associée : ce qui provient nécessairement de l’usage et de la fin du langage. 50 – Afin donc de traiter de la vision avec précision, et sans confusion, nous devons garder à l’esprit qu’il y a deux sortes d’objets appréhendés par l’œil, les uns originellement et immédiatement, les autres secondairement et par l’intermédiaire des premiers. Les objets de la première sorte ne sont ni ne paraissent être hors de l’esprit, ou à quelque distance ; ils peuvent certainement devenir plus grands ou plus petits, plus confus, plus nets ou plus pâles, mais ils ne s’approchent pas, ne s’éloignent pas — ne sauraient s’approcher ni s’éloigner de nous. Toutes les fois que nous disons qu’un objet est à distance, toutes les fois que nous disons qu’il s’approche ou qu’il s’écarte, nous devons toujours l’entendre en référence aux objets de la seconde sorte, qui appartiennent en propre au toucher, et qui ne sont pas tant perçus que suggérés par l’œil de la même manière que les pensées sont suggérées par l’oreille. 51 – Nous n’entendons pas plus tôt prononcer à notre oreille les mots d’une langue familière que les idées qui y correspondent se présentent elles-mêmes à notre esprit ; le son et le sens pénètrent exactement au même instant dans l’entendement ; ils sont si intimement liés qu’il n’est pas en notre pouvoir d’écarter l’un sans exclure l’autre aussi. Nous agissons même, à tous égards, comme si nous entendions vraiment les pensées elles-mêmes. C’est ainsi, également, que les objets secondaires, ou ceux qui sont seulement suggérés par la vue, nous affectent souvent plus fortement, et sont pris en considération plus que les objets propres de ce sens, en compagnie desquels ils entrent dans l’esprit, et avec lesquels ils sont associés bien plus étroitement que les idées avec les mots. C’est pourquoi nous trouvons qu’il est si difficile d’établir une distinction entre les objets immédiats et les objets médiats de la vue, et c’est pourquoi nous sommes si disposés à attribuer aux premiers ce qui appartient seulement aux derniers. Ils sont, pour ainsi dire, très intimement tressés, mélangés et fusionnés les uns avec les autres. Et ce préjugé est renforcé en nous, et rivé à nos pensées par une grande longueur de temps, par l’utilisation du langage et par un manque de réflexion. Pourtant, je crois que quiconque considère attentivement ce que nous avons déjà dit et ce qui nous reste à dire sur ce sujet avant d’en avoir fini (surtout s’il poursuit cette étude dans ses propres pensées) pourra être capable de se défaire de ce préjugé. Je suis sûr que cela mérite l’attention de tous ceux qui souhaitent comprendre la vraie nature de la vision. 52 – J’en ai maintenant fini avec la distance, et je vais montrer comment nous percevons par la vue la grandeur des objets. C’est l’opinion de quelques-uns que nous la percevons par des angles, ou par des angles et par la distance pris ensemble : mais ni les angles ni la distance n’étant perceptibles par la vue, et les choses que nous voyons n’étant, en vérité, à aucune distance de nous, il s’ensuit que, de même que nous avons montré que les lignes et les angles ne sont pas le moyen dont l’esprit fait usage pour appréhender la position apparente, de même ils ne sont pas non plus le moyen par lequel l’esprit appréhende la grandeur apparente des objets. 53 – Il est bien connu que la même étendue sous-tendra un angle plus grand à une proche distance, et un angle plus petit à une plus grande distance. Et l’esprit estime (nous dit-on) la grandeur d’un objet d’après ce principe, en comparant l’angle sous lequel il le voit avec sa distance, et en inférant de là sa grandeur. Ce qui incite les hommes à tomber dans cette erreur (outre l’ironie de faire voir les gens par géométrie) c’est que les mêmes perceptions, ou idées, qui suggèrent la distance suggèrent aussi la grandeur. Mais si nous examinons cela, nous trouverons qu’elles suggèrent celle-ci aussi immédiatement que celle-là. Je veux dire qu’elles ne suggèrent pas d’abord la distance pour la laisser ensuite au jugement afin qu’il s’en serve comme d’un moyen pour acquérir la grandeur, mais qu’elles ont une connexion aussi étroite et immédiate avec la grandeur qu’avec la distance, et qu’elles suggèrent la grandeur indépendamment de la distance autant qu’elles suggèrent la distance indépendamment de la grandeur. Tout cela sera évident à quiconque considère ce qui a déjà été dit, et ce qui suit. 54 – On a montré qu’il y a deux sortes d’objets appréhendés par la vue ; chacune d’elles a sa grandeur distincte, ou son étendue distincte ; l’une, proprement tangible, c’est-à-dire propre à être perçue et mesurée par le toucher, et qui ne tombe pas immédiatement sous le sens de la vue ; l’autre, proprement et immédiatement visible, et par la médiation de laquelle la première est introduite à la vue. Chacune de ces grandeurs est plus grande ou plus petite, selon qu’elle renferme en elle plus ou moins de points, car toutes sont formées de points, ou minimums. Car, quoi que l’on puisse dire de l’étendue abstraite, il est certain que l’étendue sensible n’est pas divisible à l’infini. Il y a un minimum tangible (minimum tangibile) et un minimum visible (minimum visibile) au-delà desquels les sens ne sauraient percevoir. C’est ce que chacun saura par expérience. 55 – La grandeur de l’objet qui existe hors de l’esprit, et qui est à distance, reste toujours invariablement la même, mais l’objet visible qui change sans cesse, à mesure que vous vous approchez ou que vous vous écartez de l’objet tangible, n’a aucune grandeur fixe et déterminée. Toutes les fois, donc, que nous parlons de la grandeur de quelque chose, par exemple d’un arbre ou d’une maison, nous devons entendre la grandeur tangible, car autrement on n’en peut rien dire qui soit constant et libre d’ambiguïté. Mais, bien que la grandeur tangible et la grandeur visible appartiennent en réalité à deux objets distincts, je parlerai néanmoins quelquefois d’elles (surtout parce que l’on appelle ces objets du même nom, et parce que l’on observe leur coexistence), pour éviter l’ennui et l’étrangeté du discours, comme si elles appartenaient à une seule et même chose. 56 – Pour découvrir, maintenant, par quels moyens la grandeur des objets tangibles est perçue par la vue, je n’ai besoin que de réfléchir sur ce qui se passe dans mon propre esprit, et d’observer quelles sont ces choses qui introduisent les idées de plus grand ou de plus petit dans mes pensées, lorsque je regarde un objet quel¬conque. Et je les trouve être, premièrement, la grandeur ou étendue de l’objet visible qui, étant immédiatement perçue par la vue, est associée avec cette autre grandeur qui est tangible, et qui est placée à distance ; deuxièmement, la confusion ou la netteté ; troisièmement, la vivacité ou la pâleur de l’apparence visible susdite. Tout le reste étant égal (caeteris paribus), je conclus, selon que l’objet est plus grand ou plus petit, que l’objet tangible est d’autant plus grand ou plus petit. Mais, aussi large que soit l’idée immédiatement perçue par la vue, si elle est en outre confuse, je n’en juge pas moins que la grandeur de la chose ne peut être que petite ; si elle est distincte et claire, je la juge être plus grande ; si elle est pâle, je l’appréhende comme étant encore plus grande. Ce que l’on entend ici par confusion et pâleur a été expliqué à la section 35. 57 – De plus, les jugements que nous portons sur la grandeur, tout comme ceux que nous portons sur la distance, dépendent de la disposition de l’œil, ainsi que de la figure, du nombre, de la situation des objets, et autres facteurs qui accompagnent, comme l’observation nous l’a montré, d’importantes ou de petites grandeurs tangibles. Ainsi, par exemple, exactement la même quantité d’étendue visible qui, dans la figure d’une tour, suggère l’idée d’une figure importante, suggérera, dans la figure d’un homme, l’idée d’une bien plus petite grandeur. Que cela soit dû à l’expérience que nous avons faite de la grandeur usuelle d’une tour et de celle d’un homme, je suppose que l’on n’a nul besoin de le dire. 58 – Il est également évident que la confusion ou la pâleur n’ont pas plus de connexion nécessaire avec une grandeur petite ou importante qu’elles n’en ont avec une petite ou une grande distance. De même qu’elles suggèrent celle-ci, de même elles suggèrent celle-là à nos esprits. Et, par conséquent, si ce n’était par expérience, nous ne pourrions pas plus juger qu’une apparence pâle ou confuse est associée avec une importante ou une petite grandeur, que nous ne le pourrions si elle était associée avec une grande ou une petite distance. 59 – On ne trouvera pas non plus qu’une importante ou une petite grandeur visible ait une relation nécessaire avec une importante ou une petite grandeur tangible, de telle sorte que l’on puisse, d’une façon certaine, inférer l’une de l’autre. Mais avant d’en venir à prouver cela, il est pertinent de considérer la différence qu’il y a entre l’étendue et la figure qui sont les objets propres du toucher, et cette étendue et cette figure qui sont appelées visibles ; et comment nous tenons compte des premières principalement, bien que ce ne soit pas d’une manière immédiate, lorsque nous regardons un objet quelconque. Cela a déjà été mentionné, mais nous en rechercherons ici la cause. Nous faisons attention aux objets qui nous environnent en raison de leurs dispositions à être de quelque bénéfice ou de quelque nuisance pour nos propres corps, et, par là, à produire dans nos esprits les sensations de plaisir ou de peine. Or, comme les corps opèrent sur nos organes par application immédiate, et comme le mal ou l’avantage, qui en proviennent, dépendent entièrement des qualités tangibles, et pas du tout des qualités visibles des objets, la raison pour laquelle nous devrions bien plus considérer celles-là que celles-ci est claire ; et c’est à cette fin que le sens de la vue semble avoir été accordé aux animaux, à savoir, pour que, par la perception des idées visibles (qui, en elles-mêmes, ne sont pas capables d’affecter ou de modifier d’une façon quelconque la conformation de leurs corps), ils puissent être capables de prévoir (d’après l’expérience qui leur a appris que telles idées tangibles sont associées à telles et telles idées visibles) le dommage ou le bénéfice qui sont à même de s’ensuivre au contact de leurs propres corps avec tel ou tel corps qui est à distance. Combien cette prévision est nécessaire à la préservation d’un animal, chacun peut l’apprendre par sa propre expérience. C’est pourquoi, lorsque nous regardons un objet, nous prêtons principalement attention à sa figure et son étendue tangibles, alors que nous tenons moins compte de la figure et de la grandeur visibles qui, bien qu’immédiatement perçues, nous concernent moins, et ne sont pas faites pour produire une quelconque modification dans nos corps. 60 – Qu’il en est vraiment ainsi sera évident à quiconque considère qu’un homme placé à dix pieds de distance est pensé être aussi grand que s’il était placé à une distance de seulement cinq pieds ; cela est vrai, eu égard non pas à la grandeur visible, mais à la grandeur tangible de l’objet, car la grandeur visible est bien plus importante dans une position qu’elle ne l’est dans l’autre. 61 – Les pouces, les pieds, etc., sont des longueurs stables et fixées par lesquelles nous mesurons les objets, et par lesquelles nous estimons leur grandeur ; nous disons, par exemple, qu’un objet apparaît être long de six pouces, ou de six pieds. Or il est évident que cela ne peut s’entendre des pouces visibles, etc., puisqu’un pouce visible n’a lui-même aucune grandeur constante et déterminée, et ne peut donc pas servir à délimiter et à déterminer la grandeur d’une autre chose. Prenez un pouce marqué sur une règle, regardez-le successivement à une distance d’un demi-pied, d’un pied, d’un pied et demi, etc., par rapport à l’œil : à chacune d’elles, et à toutes les distances intermédiaires, le pouce aura une étendue visible différente, c’est-à-dire que l’on discernera plus ou moins de points en lui. Je demande maintenant quelle est, de toutes ces étendues diverses, l’étendue fixe et déterminée sur laquelle on s’est accordé en vue d’une mesure commune des autres grandeurs. On ne peut donner aucune raison pour laquelle nous devrions arrêter notre choix sur l’une plutôt que sur l’autre. Et à moins d’opter pour quelque étendue invariable et déterminée qui soit désignée par le mot « pouce », il est clair que cela est d’un piètre intérêt ; et de dire qu’une chose contient tel ou tel nombre de pouces n’impliquera rien de plus que le fait, pour cette chose, d’être étendue, sans introduire dans l’esprit quelque idée particulière de cette étendue. Bien plus, un pouce et un pied déploieront tous deux, à des distances différentes, la même grandeur visible, et pourtant, vous direz au même moment que l’un semble plusieurs fois plus grand que l’autre. Il est manifeste, d’après tout cela, que les jugements que nous portons, par la vue, sur la grandeur des objets se rapportent entièrement à leur étendue tangible. Toutes les fois que nous disons qu’un objet est grand ou petit, de telle ou telle mesure déterminée, je dis que cela doit s’entendre de l’étendue tangible, et non de l’étendue visible qui, bien qu’immédiatement perçue, est néanmoins peu prise en considération. 62 – D’où il est maintenant évident qu’il n’y a aucune connexion nécessaire entre ces deux étendues distinctes, parce que nos yeux auraient pu être conformés d’une manière telle qu’ils ne fussent capables de rien voir qui ne fût inférieur au minimum tangible (minimum tangibile). Auquel cas, il n’est pas exclu que nous aurions pu percevoir tous les objets immédiats de la vue exactement tels que nous les percevons maintenant ; mais à ces apparences visibles ne seraient pas associées les différentes grandeurs tangibles qui le sont maintenant. Ce qui montre que les jugements que nous portons sur la grandeur des choses placées à distance, d’après les diverses grandeurs des objets immédiats de la vue, ne proviennent pas d’une liaison essentielle ou nécessaire, mais seulement d’une liaison coutumière que l’on a observée entre elles. 63 – De plus, il est certain non seulement qu’une idée quelconque de la vue aurait pu ne pas être associée avec telle ou telle idée du toucher que nous observons maintenant l’accompagner, mais aussi que les grandeurs visibles plus importantes auraient pu être associées avec les grandeurs tangibles plus petites et les introduire dans notre esprit, et les grandeurs visibles plus petites avec les grandeurs tangibles plus grandes. En effet, et nous faisons quotidiennement l’expérience qu’il en est réellement ainsi, un objet qui a une forte et large apparence ne semble pas, de beaucoup, aussi grand qu’un autre dont la grandeur visible est bien moindre, mais plus pâle, et dont l’apparence est située plus haut, ou, ce qui est la même chose, peinte plus bas sur la rétine, car cette pâleur et cette situation suggèrent toutes deux une grandeur plus importante et une distance plus grande. 64 – D’après cela et d’après les sections 57 et 58, il est manifeste que, de même que nous ne percevons pas immédiatement les grandeurs des objets par la vue, de même nous ne les percevons pas par la médiation de quelque chose qui a une connexion nécessaire avec elles. Ces idées, qui nous suggèrent maintenant les diverses grandeurs des objets extérieurs avant que nous ne les touchions, auraient très bien pu ne nous suggérer rien de tel ; ou bien, elles auraient pu les signifier d’une manière directement opposée, de telle sorte qu’exactement les mêmes idées, par la perception desquelles nous jugeons qu’un objet est petit, auraient pu aussi bien servir à nous faire conclure qu’il est grand ; car ces idées sont, dans leur nature propre, également aptes à introduire dans nos esprits l’idée de petitesse, de grandeur ou d’une absence totale de dimension des objets extérieurs ; tout comme les mots d’une langue quelconque sont, dans leur nature propre, indifférents à signifier telle chose, telle autre ou rien du tout. 65 – Nous voyons la distance de la même manière que nous voyons la grandeur. Et nous les voyons toutes deux de la même manière que nous voyons la honte ou la colère dans les regards d’un homme. Ces passions sont elles-mêmes invisibles ; l’œil les laisse néanmoins pénétrer en compagnie des couleurs et des modifications de la physionomie qui sont les objets immédiats de la vision, et qui les signifient pour cette unique raison que c’est simplement parce que l’on a observé qu’elles les accompagnent. Sans cette expérience, nous n’aurions pas plus pris cette rougeur pour un signe de honte que pour un signe de joie. 66 – Nous sommes néanmoins excessivement enclins à imaginer que ces choses, qui ne sont perçues que par la médiation d’autres choses, sont elles-mêmes les objets immédiats de la vue, ou, du moins, qu’elles ont dans leur nature propre une aptitude à être suggérées par elles avant que l’on n’ait jamais fait l’expérience de leur coexistence avec elles. De ce préjugé, chacun ne trouvera peut-être pas facile de se libérer, fût-ce par les preuves les plus claires de la raison. Et il y a quelque fondement à penser que, s’il n’y avait, dans le monde, qu’une seule langue invariable et universelle, et si les hommes naissaient avec la faculté de la parler, un grand nombre serait de l’opinion que les idées, qui sont dans l’esprit des autres hommes, sont proprement perçues par l’oreille, ou ont, du moins, une liaison inséparable et nécessaire avec les sons qui leur sont accolés. Tout cela semble provenir du manque d’une juste application de notre faculté discernante, par laquelle nous distinguons entre les idées qui sont dans notre entendement et les considérons chacune séparément des autres ; ce qui nous empêcherait de confondre celles qui sont différentes, et nous ferait voir quelles idées incluent ou impliquent et lesquelles n’incluent pas ou n’impliquent pas telle ou telle autre idée. 67 – Il y a un phénomène célèbre dont je vais essayer de donner la solution d’après les principes qui ont été établis sur la manière dont nous appréhendons, par la vue, la grandeur des objets. La grandeur apparente de la lune, lorsqu’elle se trouve à l’horizon, est beaucoup plus importante que lorsqu’elle est au méridien, bien que l’on n’observe pas que l’angle, sous lequel le diamètre de la lune est vu, soit plus grand dans le premier cas que dans le second ; et la lune à l’horizon n’apparaît pas être constamment de la même grosseur, mais semble, à certains moments, bien plus grande qu’à d’autres. 68 – Afin d’expliquer maintenant la raison pour laquelle la lune apparaît à l’horizon plus grande que d’ordinaire, il faut observer que les particules qui composent notre atmosphère interceptent les rayons lumineux qui vont d’un objet quelconque à l’œil ; et les rayons interceptés sont d’autant plus nombreux que la portion d’atmosphère intermédiaire entre l’objet et l’œil est plus grande, et, par conséquent, l’apparence de l’objet devient d’autant plus pâle, car chaque objet apparaît d’une manière plus vive ou plus pâle, selon qu’il envoie plus ou moins de rayons dans l’œil. Or, lorsque la lune est située à l’horizon, il y a, entre l’œil et elle, une bien plus grande quantité d’atmosphère qu’il n’y en a lorsque la lune est située au méridien. D’où il advient que l’apparence de la lune à l’horizon est plus pâle, et nous devons donc, d’après la section 56, la penser comme étant plus grosse dans cette situation qu’au méridien, ou qu’à toute autre hauteur au-dessus de l’horizon. 69 – De plus, l’air étant imprégné diversement — tantôt plus et tantôt moins — de vapeurs et d’exhalaisons aptes à retenir et à intercepter les rayons lumineux, il s’ensuit que l’apparence de la lune à l’horizon n’a pas toujours une pâleur égale, et, par conséquent, que cet astre, bien qu’exactement dans la même situation, est jugé plus grand à un moment qu’à un autre. 70 – Que nous ayons véritablement rendu compte ici du phénomène de la lune à l’horizon, cela sera, je suppose, encore plus évident pour tout le monde d’après les considérations suivantes. premièrement, il est clair que ce qui suggère, dans ce cas, l’idée d’une grandeur plus importante doit être quelque chose qui est lui-même perçu, car ce qui n’est pas perçu ne peut suggérer une autre chose à notre perception. Deuxièmement, il faut que ce soit quelque chose qui ne reste pas constamment le même, mais qui soit sujet à quelque changement ou variation, puisque l’apparence de la lune à l’horizon varie, étant plus grande à un moment qu’à un autre. Et pourtant, troisièmement, cela ne peut pas être la figure ou la grandeur visible, puisqu’elle reste la même, ou est plutôt plus petite, à mesure que la lune est plus proche de l’horizon. Il reste donc que la véritable cause est cette affection ou modification de l’apparence visible qui provient d’une plus grande pénurie de rayons arrivant jusqu’à l’œil — et que j’appelle pâleur — puisque cela répond à toutes les conditions susmentionnées, et que je n’ai pas conscience de quelque autre perception qui y réponde. 71 – Ajoutez à cela cette observation courante que, par temps brumeux, l’apparence de la lune à l’horizon est beaucoup plus large que d’habitude, ce qui contribue grandement à fortifier notre opinion. Et, s’il arrivait parfois que la lune à l’horizon semblât s’élargir au-delà de son étendue ordinaire, cela ne prouverait pas le moins du monde, même par temps serein, que c’est inconciliable avec ce que nous avons dit. Car nous devons non seulement tenir compte de la brume qui peut être sur le lieu où nous nous tenons, mais nous devons aussi prendre en considération toute l’accumulation des vapeurs et des exhalaisons qui se trouvent entre l’œil et la lune : toute cette accumulation contribuant, en effet, à rendre plus pâle l’apparence de la lune, et à augmenter ainsi sa grandeur, il peut arriver qu’elle apparaisse, même à l’horizon, plus grande qu’elle ne l’est habituellement à un moment où, bien qu’il n’y ait aucun brouillard ou aucune vapeur extraordinaire à la place même où nous nous tenons, l’air situé entre l’œil et la lune, et pris dans sa totalité, pourrait pourtant être chargé d’une plus grande quantité de vapeurs et d’exhalaisons intermédiaires qu’à d’autres moments. 72 – On peut objecter que l’interposition d’un corps, opaque à quelque degré, et capable d’intercepter une grande partie des rayons lumineux, devrait, en conséquence de nos principes, rendre l’apparence de la lune au méridien aussi large que lorsqu’elle est vue à l’horizon. A cela je réponds que ce n’est pas la pâleur utilisée d’une façon quelconque qui suggère une grandeur plus importante, car il n’y a aucune connexion nécessaire, mais seulement une connexion expérimentale entre ces deux choses. Il s’ensuit que la pâleur qui élargit l’apparence doit être utilisée de la même manière, et dans les mêmes circonstances que celles que l’on a observé accompagner la vision des grandeurs importantes. Lorsque nous apercevons de grands objets à distance, les particules de l’air et des vapeurs intermédiaires, qui sont elles-mêmes imperceptibles, interrompent les rayons lumineux et rendent ainsi l’apparence moins forte et moins vive ; or, on a fait l’expérience qu’une pâleur de l’apparence qui est causée de cette manière coexiste avec une grandeur importante. Mais, lorsqu’elle a pour cause l’interposition d’un corps sensible opaque, cette circonstance modifie le cas de figure, de sorte qu’une pâle apparence qui est causée de cette manière ne suggère pas une grandeur plus importante, parce que l’on n’a pas fait l’expérience de leur coexistence. 73 – Aussi bien que toutes les autres idées qui suggèrent la grandeur ou la distance, la pâleur les suggère de la même manière que les mots suggèrent les notions auxquelles ils sont attachés. Or, on sait qu’un mot prononcé dans certaines circonstances, ou avec d’autres mots dans un certain contexte, n’a pas toujours la même valeur et la même signification que lorsqu’il est prononcé dans d’autres circonstances ou dans un contexte différent. Exactement la même apparence visible, quant à la pâleur et à tout autre égard, ne suggérera pas, si elle est placée en hauteur, la même grandeur que si elle était vue, à distance égale, au niveau des yeux. La raison en est que nous sommes rarement accoutumés à voir les objets à une grande hauteur ; nos intérêts résident parmi les choses qui sont situées devant nous plutôt qu’au-dessus de nous ; et c’est pour cette raison que nos yeux ne sont pas placés au sommet de nos têtes, mais dans la position qui nous est la plus pratique pour voir les objets éloignés qui se trouvent sur notre route. Et puisque cette situation des yeux est un facteur qui accompagne habituellement la vision des objets éloignés, nous pouvons ainsi rendre compte du fait (communément remarqué) qu’un objet apparaît d’une grandeur différente, même en ce qui concerne son étendue horizontale, s’il est au sommet d’un clocher, par exemple, à cent pieds de haut par rapport à quelqu’un qui se tient dessous et s’il est placé à cent pieds de distance au niveau des yeux. Car on a montré que le jugement que nous portons sur la grandeur d’une chose ne dépend pas de l’apparence visible seule, mais aussi de divers autres facteurs, et que chacun d’eux, s’il manque ou s’il varie, peut suffire à provoquer quelque modification dans notre jugement. Dès lors, si ce facteur était omis — celui de voir un objet éloigné dans une situation qui lui est ordinaire, et qui s’accorde avec la position normale de la tête et des yeux — et si nous avons au lieu de cela, une situation différente de l’objet, qui requiert une position différente de la tête, il n’y aura pas à se demander si l’on juge que la grandeur de l’objet sera différente ; mais on devra se demander pourquoi un objet placé en hauteur devrait constamment apparaître plus petit qu’un objet équidistant, de même dimension et placé en bas ; car on observe qu’il en est ainsi. Il peut, en effet, être admis que la variation de quelques facteurs peut changer le jugement porté sur la grandeur des objets placés en hauteur et que nous avons moins l’habitude de regarder, mais alors, cela ne fait pas voir pourquoi nous devrions les juger plus petits plutôt que plus grands. Je réponds que, si la grandeur des objets éloignés était suggérée par la seule étendue de leur apparence visible et considérée comme leur étant proportionnelle, il est alors certain qu’ils seraient jugés bien moindres que ce qu’ils paraissent être maintenant (voir section 79). Mais, comme plusieurs facteurs concourent à former le jugement que nous portons sur la grandeur des objets éloignés, facteurs par lesquels ils apparaissent plus larges que d’autres objets dont l’apparence visible a une étendue égale, ou même plus grande, il s’ensuit que, selon le changement ou l’omission d’un quelconque de ces facteurs qui accompagnent d’habitude la vision des objets éloignés et viennent ainsi à influencer les jugements portés sur leur grandeur, ils apparaîtront proportionnellement moindres que ce qu’ils apparaîtraient sans cela. Car, si une quelconque de ces choses, qui font qu’un objet est jugé plus grand, en proportion de son étendue visible, est soit omise soit utilisée sans les facteurs usuels, le jugement dépend alors plus complètement de l’étendue visible, et par conséquent l’objet doit être jugé moindre. Ainsi, dans le cas présent, la situation de la chose vue étant différente de ce qu’elle est habituellement pour ces objets que nous avons l’occasion de voir, et dont nous observons la grandeur, il s’ensuit qu’exactement le même objet, lorsqu’il est à une hauteur de cent pieds, devra sembler moindre que s’il était à cent pieds de distance au niveau (ou quasiment) des yeux. Ce qui a été exposé ici me semble ne pas avoir contribué pour rien à grossir l’apparence de la lune à l’horizon, et mérite de ne pas être négligé lors de l’explication de ce phénomène. 74 – Si nous considérons attentivement ce phénomène, nous découvrirons que la cause principale de la difficulté qui intervient dans son explication est de ne pas distinguer les objets médiats des objets immédiats de la vue. La grandeur de la lune visible, ou ce qui est l’objet propre et immédiat de la vision, n’est pas plus importante lorsque la lune est à l’horizon que lorsqu’elle est au méridien. Comment se fait-il donc qu’elle semble, dans une situation, plus grande que dans l’autre ? Qu’est-ce qui peut tromper l’entendement ? Il n’a aucune autre perception de la lune que celle qu’il reçoit par la vue, et ce qu’il voit a la même étendue, je veux dire que l’apparence visible a la même grandeur, ou plutôt une grandeur plus petite lorsque la lune est vue à l’horizon que lorsqu’elle est au méridien ; et pourtant, elle est estimée être plus grande dans la première situation que dans la seconde. Voilà en quoi consiste la difficulté, qui s’évanouit, et qui admet une solution très facile si nous considérons que, puisque la lune visible n’est pas plus grande à l’horizon qu’au méridien, on ne pense pas non plus qu’elle le soit. On a déjà montré que, dans tout acte de vision, l’objet visible pris absolument ou en lui-même est peu pris en considération, car l’esprit porte toujours son regard vers quelques idées tangibles qui ont été observées comme étant associées avec lui, et qui en viennent ainsi à être suggérées par lui. De sorte que, lorsque l’on dit qu’une chose apparaît grande ou petite, ou quelle que soit l’estimation que l’on fait de sa grandeur, cela s’entend, non de l’objet visible, mais de l’objet tangible. Cela dûment considéré, il ne sera pas difficile du tout de résoudre la contradiction apparente qu’il y a entre le fait que la lune devrait apparaître d’une grosseur différente et celui que sa grandeur visible reste toujours la même. Car, d’après la section 56, exactement la même étendue visible suggérera, avec une pâleur différente, une étendue tangible différente. Donc, lorsque l’on dit que la lune à l’horizon apparaît plus grande qu’au méridien, il faut le comprendre, non comme une plus grande étendue visible, mais comme une plus grande étendue tangible, ou étendue réelle, qui, en raison d’une pâleur de l’apparence visible plus prononcée que d’habitude, est suggérée à l’esprit en même temps que celle-là. 75 – De nombreux essais ont été faits par de doctes personnes pour rendre compte de cette apparence. Gassendi, Descartes, Hobbes et plusieurs autres ont réfléchi sur ce sujet ; mais combien stériles et insatisfaisantes ont été leurs tentatives, les Philosophical Transactions (4) le montrent suffisamment, et vous pouvez y voir leurs diverses opinions exposées et réfutées tout au long, et, non sans quelque surprise, les bévues grossières que ces hommes ingénieux ont été forcés de commettre en tentant de concilier cette apparence avec les principes ordinaires de l’optique. Depuis ces écrits, le célèbre Dr Wallis a publié dans les Transactions (5) un autre article concernant le même sujet, et où il essaye de rendre compte de ce phénomène ; néanmoins, je vais examiner ici cet article, bien qu’il ne semble pas contenir quoi que ce soit de nouveau ou de différent par rapport à ce qui a été dit, auparavant, par d’autres. 76 – Brièvement, son opinion est celle-ci : nous ne jugeons pas de la grandeur d’un objet par l’angle visuel seul, mais, à la fois, par l’angle visuel et par la distance. Par suite, bien que l’angle reste identique, ou devienne même plus petit, l’objet apparaîtra pourtant plus grand si, en outre, la distance semble avoir augmenté. Or, un des moyens par lesquels nous estimons la distance d’une chose consiste dans le nombre et l’étendue des objets intermédiaires ; quand, donc, la lune est vue à l’horizon, la diversité des champs, des maisons, etc., conjointement avec la vaste perspective d’une immense étendue de terre ou d’eau, qui s’étale entre l’œil et l’extrême limite de l’horizon, suggèrent à l’esprit l’idée d’une grande distance, et, par conséquent, agrandissent l’apparence. Telle est, d’après le Dr Wallis, la véritable explication de la largeur extraordinaire attribuée, par l’esprit, à la lune à l’horizon, alors que l’angle sous-tendu par son diamètre n’est pas d’un iota plus grand que d’habitude. 77 – Pour ne pas répéter, à propos de cette opinion, ce qui a déjà été dit concernant la distance, je ferai seulement observer que, premièrement, si le spectacle des objets intermédiaires était ce qui suggère l’idée d’une distance plus grande, et si cette idée d’une distance plus grande était la cause qui introduit dans l’esprit l’idée d’une grandeur plus importante, il s’ensuivrait alors que, si quelqu’un regardait la lune à l’horizon de derrière un mur, elle ne devrait pas apparaître plus grosse qu’à l’ordinaire. Car, dans ce cas, le mur ampute, en s’interposant, toute cette perspective de mer, de terre, etc., qui, autrement, pourrait augmenter la distance apparente, et, par là, la grandeur apparente de la lune. Et il ne suffira pas de dire que la mémoire suggère encore à ce moment toute cette étendue de terre, etc., qui s’étale à l’horizon, car cette suggestion occasionne un jugement des sens, à savoir que la lune est plus éloignée et plus large que d’habitude. Car demandez à un homme qui, voyant la lune à l’horizon à partir d’une telle position, penserait qu’elle est plus grande que d’habitude, s’il a dans l’esprit, à ce moment, une idée quelconque des objets intermédiaires, ou d’une longue bande de terres qui s’étale entre son œil et l’extrême bord de l’horizon, et si cette idée est la cause du jugement en question. Il répondra, je suppose, par la négative, et déclarera que la lune apparaît à l’horizon plus grande qu’au méridien, bien qu’il ne pense nullement à la totalité ou à une partie quelconque de ces choses qui se trouvent entre lui et la lune. Deuxièmement, il semble impossible de rendre compte, par cette hypothèse, de ce que la lune apparaît, dans la même situation, plus grande à un moment qu’à un autre ; ce que nous avons néanmoins montré être en accord avec les principes que nous avons posés, et qui donnent à ce problème l’explication la plus simple et la plus naturelle. Pour un plus ample éclaircissement de ce point, il faut observer que nous ne voyons immédiatement et proprement que les lumières et les couleurs, dans leurs situations et leurs nuances diverses, et avec leurs degrés de pâleur et de clarté, de confusion et de distinction. Tous ces objets sont seulement dans l’esprit, et ils ne suggèrent rien d’extérieur, que ce soit la distance ou la grandeur, autrement que par une connexion habituelle, comme les mots suggèrent les choses. Nous devons aussi remarquer qu’il y a, en dehors de la contraction des yeux et en dehors de la vivacité et de la pâleur, de la distinction et de la confusion des apparences (qui, parce qu’elles ont quelque rapport avec les lignes et les angles, leur ont été substituées dans la partie précédente de ce traité), d’autres moyens qui suggèrent à la fois la distance et la grandeur : particulièrement la situation des points visibles, ou des objets visibles, selon le haut ou le bas ; l’un suggère une distance plus grande et une grandeur plus importante, l’autre une distance plus courte et une moindre grandeur. Tout cela n’est qu’un effet de la coutume et de l’expérience, puisqu’il n’y a vraiment rien d’intermédiaire, sur la ligne de distance, entre le point le plus haut et le point le plus bas qui sont tous deux équidistants de l’œil, ou plutôt à aucune distance de lui, et puisqu’il n’y a rien aussi dans le haut ou le bas qui, par une connexion nécessaire, doive suggérer une grandeur plus ou moins importante. Or, comme ces moyens empiriques et habituels de suggérer la distance suggèrent de la même manière la grandeur, ils suggèrent, ainsi, l’une aussi immédiatement que l’autre. Je veux dire qu’ils ne suggèrent pas d’abord la distance (voir section 53), et qu’ils laissent ensuite l’esprit en inférer ou en calculer la grandeur, mais qu’ils suggèrent la grandeur aussi immédiatement et directement que la distance. 78 – Ce phénomène de la lune à l’horizon est un exemple clair de l’insuffisance des lignes et des angles pour expliquer la manière dont l’esprit perçoit et estime la grandeur des objets extérieurs. Il y a néanmoins une utilisation du calcul par lignes et angles pour déterminer la grandeur apparente des choses, pour autant qu’ils soient associés et proportionnels à ces autres idées ou perceptions qui sont les occasions véritables et immédiates qui suggèrent à l’esprit la grandeur apparente des choses. Mais, d’une façon générale, on peut, je pense, remarquer au sujet du calcul mathématique en optique, qu’il ne peut jamais être très précis et très exact, puisque les jugements que nous portons sur la grandeur des choses externes dépendent souvent de plusieurs facteurs qui ne sont pas proportionnels aux lignes et aux angles, et qui ne peuvent être définis par eux. 79 – Nous pouvons, d’après ce qui a été dit, déduire sans risque cette conséquence, à savoir qu’un aveugle de naissance ayant accédé à la vue porterait, la première fois qu’il ouvre les yeux, un jugement très différent de ceux des autres hommes sur la grandeur des objets perçus par ses yeux. Il ne considérerait pas les idées de la vue en référence aux idées du toucher, ou comme ayant une connexion avec elles ; la vue qu’il en aurait se bornant entièrement à elles seules, il ne peut les juger grandes ou petites autrement que parce qu’elles contiennent un plus ou moins grand nombre de points visibles. Or, comme il est certain qu’un point visible quelconque ne peut cacher, ou interdire à la vue, qu’un seul autre point visible, il s’ensuit que tout objet qui interdit la vue d’un autre objet a le même nombre de points visibles, et, par conséquent, l’aveugle pensera qu’ils ont tous deux la même grandeur. D’où il est évident que quelqu’un jugerait, dans ces circonstances, son pouce, avec lequel il pourrait cacher une tour ou en gêner la vue, égal à cette tour, ou sa main, dont l’interposition pourrait soustraire le firmament à sa vue, égale au firmament. Si grande que puisse sembler, pour nous, une inégalité entre ces deux choses, c’est à cause de la connexion étroite et habituelle qui s’est développée dans nos esprits entre les objets de la vue et ceux du toucher, connexion par laquelle les idées très différentes et très distinctes de ces deux sens sont si mélangées et si confondues les unes avec les autres qu’elles sont prises par erreur pour une seule et même chose : préjugé dont nous ne pouvons pas facilement nous débarrasser. 80 – Pour mieux expliquer la nature de la vision, et mettre en pleine lumière la manière dont nous percevons les grandeurs, je vais procéder à quelques observations concernant des matières qui s’y rapportent, et pour lesquelles le manque d’une réflexion et d’une discrimination appropriées entre les idées tangibles et les idées visibles est propre à produire, en nous, des notions erronées et confuses. Et premièrement, je ferai remarquer que le minimum visible est exactement égal dans tous les êtres, quels qu’ils soient, qui sont dotés de la faculté visuelle. Aucune formation subtile de l’œil, aucune acuité particulière de la vue ne peut le rendre plus petit dans une créature que dans une autre, car, n’étant ni divisible en parties, ni, en aucune manière, composé de parties, il doit nécessairement être le même pour tous. Supposons, en effet, qu’il en soit autrement, et que le minimum visible d’un ciron soit plus petit que le minimum visible d’un homme, celui-ci peut donc être, par soustraction de quelque partie, égal à celui-là : il est donc composé de parties, ce qui est incompatible avec la notion de minimum visible ou point. 81 – On objectera peut-être que le minimum visible d’un homme contient vraiment en lui-même des parties par lesquelles il excède celui d’un ciron, bien qu’elles ne soient pas perceptibles par l’homme. Ce à quoi je réponds que, puisque l’on a démontré que le minimum visible (de même que tous les autres objets propres et immédiats de la vue) n’a pas d’existence hors de l’esprit qui le voit, il s’ensuit qu’il ne peut y avoir une quelconque de ses parties qui ne soit pas effectivement perçue, et donc visible. Or, pour un objet quelconque, contenir plusieurs parties visibles distinctes, et être au même moment un minimum visible, est une contradiction manifeste. 82 – Nous voyons à tout moment un nombre égal de ces points. Ce nombre est aussi grand, à la décimale près, lorsque notre vue est resserrée et limitée par des objets proches que lorsqu’elle est étendue à des objets plus vastes et plus éloignés. Car, puisqu’il est impossible qu’un seul minimum visible mette hors de vue, ou cache un seul autre minimum visible, il est clair, par conséquent, que lorsque ma vue est limitée de tout côté par les murs de mon bureau, je vois exactement autant de points visibles que si, par la suppression des murs du bureau et des autres obstacles, j’avais une perspective globale des champs d’alentour, des montagnes, de la mer et de tout le firmament ; car, tant que je suis enfermé dans ces murs, chaque point des objets extérieurs est caché à ma vue par l’interposition de ces murs, mais chaque point vu étant capable de cacher ou d’interdire à la vue un et un seul autre point correspondant, il s’ensuit que, lorsque ma vue est confinée à ces murs étroits, je vois autant de points, ou minimums visibles, que je devrais en voir, si ces murs étaient enlevés, en regardant tous les objets extérieurs que ces murs m’empêchaient de voir. Toutes les fois, donc, que l’on dit avoir une perspective plus grande à un moment qu’à un autre, il ne faut pas comprendre cela par rapport aux objets propres et immédiats de la vision, mais par rapport à ses objets secondaires et médiats qui, comme on l’a montré, appartiennent proprement au toucher. 83 – En considérant la faculté visuelle par rapport à ses objets immédiats, on peut penser qu’elle est marquée de deux défauts : premièrement, quant à l’étendue ou au nombre des points visibles qu’elle peut percevoir à la fois, nombre qui, à un certain degré, est faible et limité. Elle ne peut saisir, d’un seul coup, qu’un certain nombre déterminé de minimums visibles au-delà duquel elle ne peut étendre son champ. Deuxièmement, notre vue est défectueuse en ce que son champ d’action est non seulement étroit mais aussi confus pour la plus grande partie ; des choses que nous saisissons d’un seul regard, il n’y en a que quelques-unes que nous puissions immédiatement voir clairement et sans confusion ; et plus nous fixons notre regard sur un objet quelconque, plus le reste nous apparaît sombre et indistinct. 84 – Nous pouvons imaginer autant de perfections correspondant à ces défauts de la vue, à savoir : premièrement, celle d’embrasser d’un seul regard un plus grand nombre de points visibles. Deuxièmement, celle d’être capable de les voir tous également et immédiatement avec la plus grande clarté et la plus grande distinction. Que ces perfections ne soient pas effectivement celles de quelques intelligences d’un ordre et d’une capacité différents des nôtres, il est impossible, pour nous, de le savoir. 85 – Les microscopes ne contribuent, en aucun de ces deux cas, à l’amélioration de la vue, car, lorsque nous regardons dans un microscope, nous ne voyons pas plus de points visibles, et les points latéraux ne sont pas plus distincts que lorsque nous regardons à l’œil nu les objets placés à la bonne distance. Un microscope nous transporte, pour ainsi dire, dans un monde nouveau. Il nous présente une scène nouvelle d’objets visibles bien différents de ceux que nous apercevons à l’œil nu. Mais la différence la plus remarquable consiste en ceci : tandis que les objets perçus par l’œil seul ont avec les objets tangibles une certaine connexion par laquelle nous apprenons à prévoir ce qui résultera de l’approche ou du contact des objets distants, pour les parties de notre propre corps — ce qui contribue beaucoup à sa conservation — il n’y a pas la même connexion entre les choses tangibles et ces objets visibles que nous percevons à l’aide d’un bon microscope. 86 – Aussi est-il évident que si nos yeux se transformaient en microscope, nous ne gagnerions pas beaucoup au change ; nous serions privés de l’avantage susmentionné que nous procure actuellement la faculté visuelle, et nous en serions réduits à la seule distraction stérile de voir, sans qu’un autre bénéfice en découle. Mais on dira peut-être que, dans ce cas, notre vue serait douée d’une acuité et d’une pénétration beaucoup plus grandes qu’à présent. Mais il est certain, d’après ce que nous avons déjà montré, que le minimum visible n’est jamais plus grand ou plus petit, mais qu’il est constamment le même dans tous les cas ; et dans le cas des « yeux microscopes », je vois seulement cette différence, à savoir que par la disparition d’une certaine connexion observable entre les diverses perceptions de la vue et du toucher, connexion qui nous rendait auparavant capables de régler nos actions par les yeux, la vue serait rendue maintenant totalement inutilisable à cette fin. 87 – En somme, il semble que, si nous considérons l’usage et la fin de la vue en même temps que l’état et les circonstances de notre existence présente, nous n’y trouverons pas grand motif de nous plaindre d’un défaut ou d’une imperfection quelconque, pas plus que nous ne pourrons concevoir aisément comment elle pourrait être améliorée. Tant est admirable la sagesse avec laquelle cette faculté est agencée, à la fois pour le plaisir et la commodité de la vie. 88 – Ayant fini ce que j’avais l’intention de dire concernant la
distance et la grandeur des objets, j’en viens maintenant à traiter de
la manière dont l’esprit perçoit, par la vue, leur situation. Parmi les
découvertes du siècle dernier, est réputée non des moindres celle
d’avoir expliqué le mécanisme de la vision plus clairement qu’on ne
l’avait jamais fait auparavant. Personne, à ce jour, n’ignore que les
images des objets extérieurs se peignent sur la rétine, ou fond de l’œil
; que nous ne pouvons rien voir qui n’y soit pas ainsi peint, et que,
dans la mesure où l’image est plus distincte ou plus confuse, la
perception que nous avons de l’objet l’est aussi. Mais il se présente
alors dans cette explication de la vision une difficulté considérable.
Les objets se peignent dans un ordre inversé sur le fond de l’œil : la
partie supérieure de tout objet se peint sur la partie inférieure de
l’œil, et la partie inférieure de l’objet sur la partie supérieure de
l’œil ; et de même pour la droite et la gauche. Puisque les images sont
donc ainsi inversées, on se demande comment il se fait que nous voyions
les objets droits et dans leur position naturelle.
90 – Mais cette explication ne me semble vraie à aucun égard. Si je percevais ces impulsions, ces intersections et ces directions de rayons lumineux de la manière dont on nous l’a exposé, elle ne manquerait pas alors complètement de véracité. Et l’on pourrait prétendre à la comparaison de l’aveugle et de ses bâtons croisés. Mais le cas est tout différent. Je sais très bien que je ne perçois rien de tel. Et, par conséquent, je ne peux pas estimer ainsi la situation des objets. J’en appelle à l’expérience de chacun pour savoir s’il est lui-même conscient qu’il pense à l’intersection faite par les rayons qui se propagent, ou s’il est conscient qu’il suit les impulsions qu’ils donnent en ligne droite, toutes les fois qu’il perçoit, par la vue, la position d’un objet quelconque. Il me semble évident que jamais des enfants, des idiots ou, en vérité, aucun autre homme, n’ont pensé à l’intersection ou au tracé des rayons, à l’exception seulement de ceux qui se sont appliqués à l’étude de l’optique. Et de juger, pour l’esprit, de la situation des objets au moyen de ces choses, sans les percevoir, ou de les percevoir sans le savoir, c’est également au-delà de ma compréhension. Ajoutez à cela que l’explication du mode de la vision par l’exemple des bâtons croisés, et de la poursuite de l’objet le long des axes des rayons qui se propagent, suppose que les objets propres de la vue soient perçus à quelque distance de nous, contrairement à ce qui a été démontré. 91 – Il reste donc à chercher quelque autre explication de cette difficulté ; et je crois qu’il n’est pas impossible d’en trouver une, pourvu que nous l’examinions à fond, et que nous distinguions soigneusement les idées de la vue de celles du toucher ; ce que l’on ne saurait trop souvent répéter lorsque l’on traite de la vision ; et nous devons plus spécialement garder cette distinction à l’esprit tout au long de l’examen de cette affaire, car il semble que c’est principalement faute de l’avoir justement comprise que surgit la difficulté d’expliquer la vision à l’endroit. 92 – Pour délivrer nos esprits de toutes sortes de préjugés que nous pouvons nourrir à ce sujet, rien ne me semble plus pertinent que de considérer le cas d’un aveugle de naissance qui, après avoir grandi, accède à la vue. Et bien que, peut-être, cela ne soit pas une tâche facile de nous dépouiller entièrement de l’expérience acquise par la vue, de manière à pouvoir adapter exactement nos pensées à la situation d’un tel homme, nous devons néanmoins tenter de nous faire, autant que possible, une idée juste de ce que l’on pourrait raisonnablement supposer sur ce qui se passe dans son esprit. 93 – Il est certain qu’un homme réellement aveugle, et qui le serait depuis sa naissance, parviendrait, par le sens du toucher, à avoir les idées de haut et de bas. Il pourrait, par le mouvement de sa main, discerner la situation d’un quelconque objet tangible placé à sa portée. Cette partie sur laquelle il sent qu’il s’appuie, ou vers laquelle il perçoit que son corps est attiré, il la nommera basse, et la partie opposée haute ; et il dénommera, conformément à cette terminologie, tous les objets qu’il touche. 94 – Mais alors, les jugements qu’il porte sur la situation des objets sont, quels qu’ils soient, limités à ceux qui sont perceptibles par le toucher. A toutes ces choses qui sont intangibles et de nature spirituelle, ses pensées et ses désirs, ses passions et, en général, toutes les modifications de l’âme, il n’appliquerait jamais les termes de haut et de bas, excepté seulement dans un sens métaphorique. Peut-être, peut-il, de manière allusive, parler de hautes ou de basses pensées. Mais ces termes, dans leur signification propre, ne sauraient jamais s’appliquer à quelque chose qui ne fut pas conçu comme existant hors de l’esprit. Car un aveugle de naissance, qui est resté dans cet état, ne pourrait rien vouloir dire d’autre par les mots de plus haut et de plus bas qu’une plus ou moins grande distance par rapport à la terre, distance qu’il mesurerait par le mouvement ou l’application de sa main, ou de quelque autre partie de son corps. Il est donc évident que toutes ces choses qu’il considérerait, l’une par rapport à l’autre, comme plus hautes ou plus basses, doivent être telles qu’elles furent conçues comme existant hors de l’esprit, dans l’espace environnant. 95 – D’où il suit clairement qu’un tel homme, si nous supposons qu’il accède à la vue, ne penserait pas, à son premier regard, que ce qu’il voit est en haut ou en bas, à l’endroit ou à l’envers, car il a été démontré à la section 41 qu’il ne penserait pas que les choses qu’il perçoit soient à quelque distance de lui, ou hors de son esprit. Les objets auxquels il avait, jusqu’ici, l’habitude d’appliquer les termes de haut et de bas, de supérieur et d’inférieur, ne le méritaient qu’en tant qu’ils affectaient son toucher, ou qu’ils étaient perçus d’une certaine manière par lui ; mais les objets propres de la vision constituent un nouvel ensemble d’idées parfaitement distinctes et différentes des précédentes, et qui ne peuvent, en aucune façon, se faire percevoir par le toucher. Il n’y a donc absolument rien qui pouvait l’induire à penser que ces termes leur sont applicables ; et il ne le penserait jamais avant qu’il n’eût observé leur connexion avec les objets tangibles, et avant que n’eût commencé à s’insinuer dans son entendement ce même préjugé, qui s’est développé, depuis l’enfance, dans l’entendement des autres hommes. 96 – Pour mieux mettre cette question en pleine lumière, j’utiliserai un exemple. Supposons que l’aveugle mentionné ci-dessus perçoive, par le toucher, qu’un homme se tient droit. Analysons la manière dont cela se fait. Par application de sa main sur les diverses parties d’un corps humain, il a perçu différentes idées tangibles qui, en s’unissant en plusieurs idées complexes, ont des noms distincts qui leur sont attachés. Ainsi, la combinaison d’une certaine figure tangible, d’un certain volume tangible et d’une certaine cohérence tangible des parties est appelée la tête, une autre la main, une troisième le pied, et de même pour le reste. Toutes ces idées complexes peuvent, dans son entendement, être seulement composées d’idées perceptibles par le toucher. Il a aussi acquis par le toucher une idée de la terre ou du sol vers lequel il sent que les parties de son corps tendent naturellement. Or, droit ne signifiant rien de plus que cette position perpendiculaire d’un homme dans laquelle ses pieds sont le plus près de la terre, si l’aveugle en promenant sa main sur les membres de l’homme qui se tient devant lui perçoit que les idées tangibles qui composent la tête sont le plus éloignées de cette autre combinaison d’idées tangibles qu’il appelle terre, et que celles qui composent les pieds en sont le plus rapprochées, il dira que l’homme se tient droit. Mais si nous supposons qu’il accède subitement à la vue, et qu’il aperçoive un homme debout devant lui, il est évident, dans ce cas, qu’il ne jugera l’homme qu’il voit ni droit ni renversé, car, n’ayant jamais su appliquer ces termes à autre chose qu’aux choses tangibles, ou qu’à celles qui existent dans l’espace en dehors de lui, et ce qu’il voit n’étant ni tangible ni perçu comme existant au-dehors, il ne pouvait pas savoir que, en toute propriété de langage, ces termes étaient applicables ici. 97 – Par la suite, lorsqu’il observera que, en tournant la tête vers le haut et le bas, la droite et la gauche, les objets visibles changent, et lorsqu’il arrivera aussi à savoir qu’ils sont appelés par les mêmes noms, et qu’ils sont associés avec les objets perçus par le toucher, alors, il en viendra, en effet, à parler d’eux et de leur situation dans les termes mêmes qu’il a eu l’habitude d’appliquer aux choses tangibles ; et des objets qu’il perçoit en levant les yeux, il dira qu’ils sont plus hauts, et de ceux qu’il perçoit en baissant les yeux, il dira qu’ils sont plus bas. 98 – Et cela me semble être la vraie raison pour laquelle il doit penser comme étant le plus élevés les objets qui se peignent sur la partie inférieure de l’œil, car ils seront vus distinctement en levant les yeux ; de même que ceux qui se peignent sur la plus haute partie de l’œil seront vus distinctement en baissant les yeux, et sont, pour cette raison, estimés le plus bas ; car nous avons montré qu’il n’attribuerait pas aux objets immédiats de la vue, considérés en eux-mêmes, les termes de haut et de bas. Cela doit donc être à cause de quelques facteurs dont on a observé qu’ils les accompagnent ; et il est clair que ces facteurs sont les actions de lever et de baisser les yeux, actions qui nous suggèrent une raison très évidente pour laquelle l’esprit doit appeler, par conséquent, les objets de la vue par les noms de haut ou de bas. Et sans ce mouvement des yeux, sans cette action de les lever et de les baisser pour discerner les différents objets, droit, renversé, et autres termes semblables relatifs à la position des objets tangibles, n’auraient, sans doute, jamais été ni transférés aux idées de la vue, ni considérés comme s’y rapportant d’aucune façon ; car le simple acte de voir n’inclut rien de tel dans ce sens, alors que les différentes positions de l’œil amènent naturellement l’esprit à faire un jugement adéquat de la situation des objets introduits par la vue. 99 – De plus, lorsqu’il aura connu, par expérience, la connexion qu’il y a entre les diverses idées de la vue et du toucher, il sera capable, par la perception qu’il a de la situation des choses visibles les unes par rapport aux autres, de faire une estimation immédiate et vraie de la situation des choses tangibles extérieures qui y correspondent. Et c’est ainsi qu’il percevra, par la vue, la situation des objets extérieurs qui ne relèvent pas proprement de ce sens. 100 – Je sais que nous sommes fort enclins à penser que, si nous venions juste d’accéder à la vue, nous jugerions de la situation des choses visibles comme nous le faisons maintenant. Mais nous avons aussi la même propension à penser qu’à nos premiers regards nous appréhenderions la distance et la grandeur des objets comme nous le faisons maintenant ; or, nous avons montré que c’est une conviction fausse et sans fondement. Et pour les mêmes raisons, on peut émettre une critique semblable sur l’assurance catégorique que la plupart des hommes, avant qu’ils n’aient réfléchi suffisamment à ce sujet, pourraient avoir sur leur capacité à déterminer par la vue, au premier regard, si les objets sont droits ou inversés. 101 – Peut-être objectera-t-on à notre opinion que, si l’on pense, par exemple, qu’un homme est droit lorsque ses pieds sont contigus à la terre, et renversé lorsque sa tête est contiguë à la terre, il s’ensuit que, par le simple acte de la vision, sans expérience ou sans modification de la position de l’œil, nous aurions dû déterminer si cet homme est droit ou renversé ; car, puisque la terre elle-même aussi bien que les membres de l’homme qui s’y tient debout sont également perçus par la vue, on ne peut pas s’empêcher de voir quelle partie de l’homme est le plus proche de la terre et quelle partie en est le plus éloignée, c’est-à-dire s’il est droit ou renversé. 102 – A cela je réponds que les idées qui constituent la terre et l’homme tangibles sont entièrement différentes de celles qui constituent la terre et l’homme visibles. Et il n’aurait pas été possible, en vertu de la seule faculté visuelle, et sans y ajouter quelque expérience du toucher, ou sans modification de la position de l’œil, d’avoir jamais su, ou seulement soupçonné, qu’il y eut quelque relation ou connexion entre elles. Par suite, un homme n’appellerait pas ce qu’il a vu, à son premier regard, terre, tête ou pied ; et, par conséquent, il ne pourrait pas dire, par le simple acte de voir, si c’est la tête ou les pieds qui étaient le plus près de la terre. Et nous n’aurions vraiment, de cette manière, aucune idée de terre ou d’homme, de droit ou de renversé ; ce qui sera rendu encore plus évident si nous observons soigneusement les idées des deux sens, et si nous les comparons entre elles d’une manière détaillée. 103 – Ce que je vois est seulement une diversité de lumière et de couleurs. Ce que je sens est dur ou mou, chaud ou froid, rugueux ou lisse. Quelle similitude, quelle connexion ces idées-ci ont-elles avec celles-là ? Ou, comment est-il possible que l’on puisse trouver une raison de donner un seul et même nom à des combinaisons d’idées si différentes, avant d’avoir fait l’expérience de leur coexistence ? Nous trouvons qu’il n’y a pas de connexion nécessaire entre telle et telle qualité tangible et une couleur, quelle qu’elle soit. Et nous pouvons parfois percevoir des couleurs là où il n’y a rien à sentir. Tout cela montre manifestement qu’aucun homme, la première fois qu’il accède à la vue, ne saurait qu’il y a un accord quelconque entre tel et tel objet particulier de la vue et un objet quelconque du toucher qu’il connaissait déjà. Les couleurs de la tête ne lui suggéreraient donc pas plus l’idée de la tête que celle du pied. 104 – Bien plus, nous avons longuement montré (voir sections 63 et 64) que l’on ne peut découvrir aucune connexion nécessaire entre une quelconque grandeur visible donnée et une quelconque grandeur tangible particulière, mais que c’est entièrement par le résultat de la coutume et de l’expérience, et par le rapport à des facteurs étrangers et accidentels, que nous pouvons, par la perception de l’étendue visible, nous instruire de ce que peut être l’étendue d’un objet tangible quelconque qui y est associé. Il est donc certain que ni la grandeur visible de la tête, ni celle du pied n’introduiraient avec elles dans l’esprit, la première fois que s’ouvrent les yeux, les grandeurs tangibles respectives de ces parties du corps. 105 – D’après la section précédente, il est clair que la figure visible d’une partie quelconque du corps n’a aucune connexion nécessaire avec sa figure tangible, de sorte qu’elle puisse, au premier regard, la suggérer à l’esprit ; car la figure est la limite de la grandeur ; il s’ensuit alors que, puisque aucune grandeur visible n’est apte, par sa nature propre, à suggérer une quelconque grandeur tangible particulière, une quelconque figure visible ne peut pas non plus être associée inséparablement avec sa figure tangible correspondante, de sorte qu’elle pourrait, d’elle-même et antérieurement à l’expérience, la suggérer à l’entendement. Cela sera encore plus évident si nous considérons que ce qui semble si lisse et rond au toucher peut, si on le regarde dans un microscope, apparaître tout autrement à la vue. 106 – En rassemblant et en considérant dûment tout cela, nous pouvons clairement tirer cette conclusion : la première fois que s’exerce la vision, aucune des idées pénétrant par l’œil n’aura une connexion perceptible avec les idées auxquelles les noms de terre, d’homme, de tête, de pied, etc., ont été associés dans l’entendement d’une personne aveugle depuis sa naissance ; de sorte qu’elles puissent les introduire, d’une façon quelconque, dans son esprit, ou qu’elles puissent se faire appeler par les mêmes noms, et considérer comme les mêmes choses, ainsi que cela se produira plus tard. 107 – Il reste néanmoins une difficulté qui peut sembler peut-être compromettre fortement notre opinion et qui ne mérite pas d’être passée sous silence. Car, bien qu’il soit admis que ni la couleur, ni la taille, ni la figure des pieds visibles n’ont une connexion nécessaire avec les idées qui composent les pieds tangibles — de sorte qu’elles puissent les introduire, au premier regard, dans mon esprit, ou qu’elles puissent me mettre en danger de les confondre avant que je ne me sois habitué à leur connexion, et que je n’en aie fait pendant quelque temps l’expérience — il semble, cependant, vraiment indéniable que, le nombre des pieds visibles étant le même que celui des pieds tangibles, je puisse raisonnablement en conclure, sans expérience de la vue, qu’ils représentent les pieds plutôt que la tête, ou qu’ils leur sont associés. Je veux dire qu’il semble que l’idée de deux pieds visibles suggérera à l’esprit l’idée de deux pieds tangibles plutôt que celle d’une tête, de sorte que l’aveugle, la première fois qu’il accède à la faculté visuelle, pourrait savoir laquelle est les pieds, c’est-à-dire deux, et laquelle est la tête, c’est-à-dire une. 108 – Pour tirer au clair cette difficulté apparente, il nous faut seulement observer que la diversité des objets visibles n’entraîne pas nécessairement la diversité des objets tangibles qui leur correspondent. Un tableau peint avec une grande variété de couleurs affecte le toucher d’une manière uniforme ; il est donc évident que je ne juge pas, par une déduction nécessaire et indépendante de l’expérience, du nombre des choses tangibles d’après le nombre des choses visibles. Je ne conclurai donc pas en ouvrant les yeux pour la première fois que, parce que je vois deux, je sentirai deux. Comment donc puis-je savoir, avant que l’expérience ne me l’apprenne, que les jambes visibles, parce qu’elles sont deux, sont associées avec les jambes tangibles, ou que la tête visible, parce qu’elle est une, est associée avec la tête tangible ? La vérité, c’est que les choses que je vois sont si différentes des choses que je touche, et leur sont si hétérogènes, que la perception des unes ne m’aurait jamais suggéré les autres, ou ne m’aurait jamais rendu capable de porter le moindre jugement sur elles jusqu’à ce que j’eusse fait l’expérience de leur connexion. 109 – Mais, pour élucider plus complètement ce point, il nous faut considérer que le nombre (bien que certains puissent le compter parmi les qualités premières) n’est rien de fixe et d’établi qui existe réellement dans les choses elles-mêmes. C’est uniquement une création de l’esprit qui considère soit une idée par elle-même, soit une combinaison d’idées à laquelle il donne un nom, et qu’il fait ainsi passer pour une unité. Selon que l’esprit combine différemment ses idées, l’unité varie, et comme l’unité, varie aussi le nombre qui n’est qu’une collection d’unités. Nous disons qu’une fenêtre est une, qu’une cheminée est une, et pourtant, une maison dans laquelle il y a plusieurs fenêtres et plusieurs cheminées a autant le droit de se dire une, et plusieurs maisons en viennent à faire une ville. Dans ces exemples et dans d’autres semblables, il est évident que l’unité se rapporte constamment aux découpages que l’esprit fait de ses idées, découpages auxquels il appose des noms, et dans lesquels il englobe plus ou moins d’idées, selon que cela convient le mieux à ses propres buts et à ses propres desseins. Est donc une unité tout ce que l’esprit considère comme un. Chaque combinaison d’idées est considérée comme une chose par l’esprit, et pour en témoigner, est désignée par un nom. or, cette opération de nommer et de combiner ensemble des idées est parfaitement arbitraire, et l’esprit l’accomplit de la manière que l’expérience lui a montrée la plus commode, expérience sans laquelle nos idées n’auraient jamais été combinées dans ces collections diverses et distinctes, comme elles le sont maintenant. 110 – D’où il suit qu’un aveugle de naissance qui, une fois adulte, accède à la vue, ne distribuerait pas, la première fois qu’il voit, ses idées visuelles dans les mêmes collections distinctes que les autres hommes, qui ont fait l’expérience des idées qui coexistent régulièrement, et qui sont propres à être empaquetées ensemble sous un seul nom. Il ne ferait pas, par exemple, une idée complexe, qu’il considérerait ainsi comme une unité, de toutes ces idées particulières qui constituent la tête ou le pied visibles. Car on ne peut donner aucune raison pour laquelle il devrait faire ainsi, au simple vu d’un homme qui se tient droit devant lui. Les idées qui composent l’homme visible se pressent dans son esprit en compagnie de toutes les autres idées de la vue qu’il perçoit au même moment. Mais toutes ces idées qui s’offrent d’un seul coup à son regard, il ne pourrait pas les distribuer en diverses combinaisons distinctes avant d’arriver, par l’observation du mouvement des parties de l’homme, et par d’autres expériences, à savoir lesquelles doivent être mises ensemble. 111 – D’après ce que l’on a posé comme prémisse, il est clair que les objets de la vue et du toucher forment, si je puis dire, deux ensembles d’idées largement différents l’un de l’autre. Nous attribuons indifféremment aux objets de l’un ou l’autre genre les termes de haut et de bas, de droite et de gauche, et autres termes semblables, qui dénotent la position ou la situation des choses. Mais il nous faut alors bien observer que la position d’un objet quelconque n’est déterminée que par rapport aux objets du même sens. Nous disons d’un objet quelconque du toucher qu’il est en haut ou en bas, selon qu’il est plus ou moins distant de la terre tangible ; et, de même, nous appelons un objet quelconque de la vue haut ou bas, selon qu’il est plus ou moins distant de la terre visible. Mais de définir la situation des choses visibles par rapport à la distance qu’elles ont avec une chose tangible quelconque, ou vice versa, cela serait absurde et parfaitement inintelligible. Car toutes les choses visibles sont également dans l’esprit, et n’occupent aucune partie de l’espace extérieur ; elles sont, par conséquent, équidistantes de toute chose tangible qui existe hors de l’esprit. 112 – Ou plutôt, à dire vrai, les objets propres de la vue ne sont à aucune distance, ni près ni loin, d’une chose tangible. Car, si nous examinons rigoureusement le sujet, nous verrons que seules se comparent les unes avec les autres, du point de vue de la distance, les choses qui existent de la même manière, ou qui appartiennent au même sens. Car la distance entre deux points quelconques ne veut rien dire de plus que le nombre des points intermédiaires. Si les points donnés sont visibles, la distance entre eux est fixée par le nombre de points visibles intermédiaires ; s’ils sont tangibles, la distance entre eux est une ligne qui consiste en points tangibles ; mais s’ils sont l’un tangible et l’autre visible, la distance entre eux ne consiste ni en points perceptibles par la vue, ni en points perceptibles par le toucher, c’est-à-dire qu’elle est absolument inconcevable. Tous les hommes n’admettront peut-être pas cela facilement dans leur entendement. Quoi qu’il en soit, je serai heureux d’apprendre de toute personne qui aura pris la peine d’y réfléchir un peu, et qui y aura appliqué à fond ses pensées, si cela n’est pas vrai. 113 – Ne pas avoir observé ce qui a été communiqué dans les deux dernières sections semble avoir une bonne part de responsabilité dans la difficulté qui se présente à propos des apparences droites. La tête qui se peint le plus près de la terre semble en être le plus éloignée ; et, par ailleurs, les pieds qui se peignent le plus loin de la terre sont considérés comme le plus près d’elle. Voilà où réside la difficulté qui s’évanouit si nous exprimons la chose plus clairement et sans ambiguïté, comme suit : comment se fait-il que la tête visible qui est le plus près de la terre tangible, semble, pour l’œil, le plus éloignée de la terre, et que les pieds visibles qui sont le plus éloignés de la terre tangible, semblent le plus près de la terre ? La question étant ainsi posée, qui ne voit que la difficulté est fondée sur la supposition que l’œil, ou la faculté visuelle, ou plutôt l’âme par son moyen, doit juger de la situation des objets visibles en ce qui concerne leur distance à la terre tangible ? Alors qu’il est évident que la terre tangible n’est pas perçue par la vue. Et l’on a démontré, dans les deux précédentes sections, que la place des objets visibles n’est déterminée que par la distance qu’ils affirment les uns par rapport aux autres, et que c’est un non-sens de parler de distance, lointaine ou proche, entre une chose visible et une chose tangible. 114 – Si nous nous bornons à penser aux objets propres de la vue, tout cela est clair et facile. La tête se peint le plus loin de la terre visible, et les pieds le plus près ; et c’est ainsi qu’ils apparaissent être. Qu’y a-t-il d’étrange ou d’inexplicable en cela ? Supposons que les peintures sur le fond de l’œil soient les objets immédiats de la vue. La conséquence, c’est que les choses devraient apparaître dans la position même où elles sont peintes ; et n’en est-il pas ainsi ? La tête que nous voyons semble le plus loin de la terre que nous voyons ; et les pieds que nous voyons semblent le plus près de la terre que nous voyons ; et c’est exactement ainsi qu’elles sont peintes. 115 – Mais, direz-vous, la peinture de l’homme est inversée, et pourtant, son apparence est droite. Je vous demande ce que vous entendez par la peinture de l’homme est inversée ou, ce qui est la même chose, par l’homme visible est inversé. Vous me dites que vous entendez par « la tête est tout en bas » qu’elle est le plus près de la terre, et par « les talons sont tout en haut » qu’ils sont le plus loin de la terre. Je vous demande de nouveau : de quelle terre voulez-vous parler ? Vous ne pouvez pas parler de la terre qui est peinte sur l’œil, ou de la terre visible, car la peinture de la tête est le plus éloignée de la peinture de la terre ; et, par conséquent, la tête visible est le plus éloignée de la terre visible, et les pieds visibles en sont le plus proches. Il reste donc que vous voulez parler de la terre tangible, et déterminer ainsi la situation des choses visibles par rapport aux choses tangibles, contrairement à ce qui a été démontré aux sections 111 et 112. Les deux provinces distinctes de la vue et du toucher devraient être considérées séparément, et comme si leurs objets n’avaient, quant à la distance ou à la position, aucun commerce et aucune relation les uns avec les autres. 116 – De plus, ce qui contribue grandement à nous induire en erreur sur ce sujet, c’est que, lorsque nous pensons aux peintures sur le fond de l’œil, nous nous imaginons en train de regarder le fond de l’œil d’un autre homme, ou nous nous imaginons que quelqu’un d’autre regarde le fond de notre propre œil, et perçoit les peintures qui y sont peintes. Supposons deux yeux A et B ; en regardant à quelque distance les peintures en B, A les voit inversées, et conclut, pour cette raison, qu’elles sont inversées en B. Mais cela est faux. Ce qui est projeté en petit sur le fond de A, ce sont les images des peintures, supposons, d’un homme, de la terre, etc., qui sont peintes sur B. Et, outre cela, l’œil B lui-même et les objets qui l’environnent, ainsi qu’une autre terre sont projetés en plus grandes dimensions sur A. Or, ces plus grandes images sont considérées par l’œil A comme les véritables objets, et les plus petites, seulement comme des peintures en miniature. Et c’est par rapport à ces plus grandes images qu’il détermine la situation des images plus petites, de sorte qu’en comparant le petit homme avec la grande terre, A le juge inversé, ou juge que les pieds sont le plus éloignés de la grande terre, et la tête le plus rapprochée. Tandis que, si A compare le petit homme avec la petite terre, il lui apparaîtra alors droit, c’est-à-dire que sa tête semblera être le plus éloignée de la petite terre, et ses pieds le plus rapprochés. Mais il nous faut remarquer que B ne voit pas deux terres comme A : il ne voit que ce qui est représenté par les petites peintures en A, et il jugera, par conséquent, que l’homme est droit. En vérité, l’homme n’est pas inversé en B, car, chez lui, les pieds sont proches de la terre ; mais c’est sa représentation en A qui est inversée, car la tête de la représentation de la peinture de l’homme en B y est proche de la terre, et les pieds y sont le plus éloignés, en entendant par terre celle qui est en dehors de la représentation des peintures en B. Car si vous prenez les petites images des peintures en B, et que vous les considériez en elles-mêmes, elles sont toutes droites et dans leur position naturelle. 117 – De plus, nous nous trompons en nous imaginant que les peintures des objets extérieurs se peignent sur le fond de l’œil. On a montré qu’il n’y a aucune ressemblance entre les idées de la vue et des choses tangibles. On a démontré, de même, que les objets propres de la vue n’existent pas en dehors de l’esprit. D’où il suit clairement que les peintures peintes sur le fond de l’œil ne sont pas les peintures des objets extérieurs. Que chacun examine ses propres pensées, et qu’il dise, alors, quelle affinité, quelle ressemblance il y a entre cette variété et cette disposition précise de couleurs qui constituent l’homme visible, ou peinture d’un homme, et cette autre combinaison d’idées fort différentes, sensibles au toucher, qui composent l’homme tangible. Mais, si c’est le cas, comment en viennent-elles à être considérées comme des peintures ou des images, puisque cela suppose qu’elles copient ou qu’elles représentent des originaux, quels qu’ils soient ? 118 – A quoi je réponds : dans l’exemple susmentionné l’œil A prend les petites images, comprises dans la représentation de l’autre œil B, pour des peintures ou des copies dont les archétypes ne sont pas des choses existant au-dehors, mais les peintures plus grandes projetées sur son propre fond, et qui ne sont pas considérées par A comme des peintures, mais comme les originaux ou les véritables choses elles-mêmes. Mais, si nous supposons qu’un troisième œil C aperçoive, à la distance voulue, le fond de A, alors les choses qui y sont projetées sembleront être, en effet, à C, des peintures ou des images, de la même manière que celles projetées sur B semblent l’être à A. 119 – Pour bien concevoir ce point, nous devons distinguer soigneusement entre les idées de la vue et celles du toucher, entre l’œil visible et l’œil tangible ; car, certainement, rien n’est peint ou ne semble être peint sur l’œil tangible. D’ailleurs, on a montré que l’œil visible, aussi bien que tous les autres objets visibles, n’existe que dans l’esprit qui, percevant ses propres idées et les comparant entre elles, en appelle certaines peintures, par rapport à d’autres. Ce qui a été dit, une fois rassemblé et bien compris, fournit, je pense, une explication simple et complète de l’apparence droite des objets ; phénomène qui, je dois l’avouer, ne me paraît pas pouvoir être expliqué par une quelconque des théories de la vision qui, jusqu’à présent, s’est fait connaître. 120 – Lorsque l’on traite de ces choses, l’emploi du langage est propre à occasionner quelque obscurité et quelque confusion, et à produire en nous des idées fausses. Car, le langage étant adapté aux notions communes et aux préjugés ordinaires des hommes, il est à peine possible d’exposer la vérité exacte et nue, sans de grandes circonlocutions, impropriétés et (pour un lecteur inattentif) contradictions apparentes ; je désire donc, une fois pour toutes, que celui qui croira qu’il vaut la peine de comprendre ce que j’ai écrit concernant la vision ne s’attache pas à telle ou telle phrase, à telle ou telle manière de m’exprimer, mais qu’il recueille sincèrement ma pensée de tout l’ensemble et de toutes les grandes lignes de mon discours, et qu’il laisse les mots de côté autant que possible pour ne considérer que les pures notions elles-mêmes, et qu’alors il juge si elles agréent, ou non, à la vérité et à sa propre expérience. 121 – Nous avons montré la manière dont l’esprit, par la médiation des idées visibles, perçoit ou appréhende la distance, la grandeur et la situation des objets tangibles. Nous en venons maintenant, à propos de la différence qu’il y a entre les idées de la vue et du toucher, à chercher plus particulièrement lesquelles sont appelées par les mêmes noms et s’il y en a une commune aux deux sens. D’après ce que nous avons longuement exposé et démontré dans les parties précédentes de ce traité, il est clair qu’il n’y a aucune étendue numérique semblable à elle-même perçue à la fois par la vue et par le toucher ; mais que les figures et les étendues particulières perçues par la vue, quoiqu’elles puissent être appelées par les mêmes noms, et quoiqu’elles puissent passer pour les mêmes choses que celles qui sont perçues par le toucher, sont néanmoins différentes, et ont une existence distincte et séparée de celles-ci ; aussi, la question ne concerne plus maintenant les mêmes idées numériques, mais est celle de savoir s’il y a une seule et même sorte ou espèce d’idées, qui soit également perceptible par les deux sens ; ou, en d’autres termes, si l’étendue, la figure et le mouvement perçus par la vue ne sont pas spécifiquement distincts de l’étendue, de la figure et du mouvement perçus par le toucher. 122 – Mais, avant que je n’en arrive à discuter plus particulièrement ce sujet, je crois bon de considérer l’étendue prise abstraitement. Car on en parle beaucoup, et je suis enclin à penser que, lorsque les hommes parlent de l’étendue comme d’une idée commune aux deux sens, c’est avec la supposition cachée que nous pouvons détacher l’étendue de toutes les autres qualités tangibles et visibles, et nous en former une idée abstraite en voulant qu’elle soit, à la fois, commune à la vue et au toucher. Nous devons donc comprendre par étendue abstraite une idée de l’étendue, par exemple une ligne ou une surface, entièrement dépouillée de toutes les autres qualités et de tous les facteurs sensibles qui pourraient lui déterminer quelque existence particulière ; elle n’est ni noire, ni blanche, ni rouge, elle n’a pas de couleur du tout, ni aucune qualité tangible, quelle qu’elle soit, et par conséquent, aucune grandeur finie et déterminée, car de qui limite ou distingue une étendue d’une autre, c’est quelque qualité ou facteur par où elles diffèrent entre elles. 123 – Or, je ne pense pas que je puisse percevoir, imaginer ou devoir d’aucune manière, dans mon esprit, une idée abstraite telle qu’elle est décrite ici. Une ligne ou une surface qui n’est ni blanche, ni bleue, ni jaune, etc., ni longue, ni courte, ni rugueuse, ni lisse, ni carrée, ni ronde, etc., est parfaitement incompréhensible. En ce qui me concerne, j’en suis sûr, mais jusqu’à quel point les facultés des autres hommes peuvent prétendre, ce sont eux qui peuvent le dire le mieux. 124 – On dit communément que l’objet de la géométrie est l’étendue abstraite ; mais la géométrie envisage les figures. Or, la figure est le contour de la grandeur, mais nous avons montré que l’étendue abstraite n’a pas de grandeur finie déterminée. D’où il suit clairement qu’elle ne peut avoir aucune figure, et, par conséquent, qu’elle n’est pas l’objet de la géométrie. C’est, en effet, un principe des philosophes, tant modernes qu’anciens, que toutes les vérités générales concernent les idées universelles abstraites, sans lesquelles, nous dit-on, il ne pourrait y avoir aucune science, aucune démonstration d’une proposition générale en géométrie. Mais il ne serait pas difficile, si je le croyais nécessaire à mon présent dessein, de montrer que les propositions et les démonstrations géométriques pourraient être universelles, quand bien même leurs auteurs n’eussent jamais pensé aux idées générales abstraites de triangle ou de cercle. 125 – Après des tentatives réitérées pour appréhender l’idée générale d’un triangle, j’ai constaté qu’elle était tout à fait incompréhensible. Et, certainement, si quelqu’un était capable d’introduire cette idée dans mon esprit, ce devrait être l’auteur de l’Essai concernant l’entendement humain, lui qui s’est tant distingué de la majorité des écrivains par la clarté et la portée de son propos. Voyons donc comment cet auteur célèbre décrit l’idée générale ou abstraite d’un triangle. « Il ne doit être, dit-il, ni oblique, ni rectangle, ni équilatéral, ni isocèle, ni scalène, mais tout cela à la fois, et rien de tout cela. En fait, c’est quelque chose d’imparfait qui ne peut exister ; c’est une idée dans laquelle des parties de plusieurs idées différentes et incompatibles sont mises ensemble » (Essai concernant l’entendement humain, L. IV, ch. 7, sect. 9). Telle est l’idée qu’il pense nécessaire au développement de la connaissance, idée qui est l’objet de la démonstration mathématique, et sans laquelle nous ne pourrions jamais arriver à connaître aucune proposition générale concernant les triangles. Cet auteur reconnaît « qu’il requiert quelque peine et quelque adresse pour former cette idée générale du triangle » (ibid.). Mais s’il s’était rappelé ce qu’il dit à un autre endroit, à savoir que « ces idées de modes mixtes dans lesquelles des idées incompatibles sont mises ensemble ne peuvent pas même exister dans l’esprit, c’est-à-dire être conçues » (voir L. III, ch. 9, sect. 33) ; si cela, dis-je, s’était présenté à son esprit, il n’est pas improbable qu’il aurait reconnu que, former l’idée susdite d’un triangle — idée qui est faite de contradictions manifestes et frappantes — est au-delà de toutes les peines, et de toute l’adresse dans laquelle il était passé maître. Qu’un homme qui insistait tant sur les idées claires et déterminées ait pu néanmoins parler de la sorte semble vraiment surprenant. Mais l’étonnement diminuera si l’on considère que la source d’où cette opinion provient est la matrice prolifique qui a produit des erreurs et des difficultés innombrables dans toutes les parties de la philosophie et dans toutes les sciences. Mais ce sujet, pris dans toute son ampleur, est trop vaste pour qu’on y insiste ici. Et voilà pour l’étendue abstraite. 126 – Certains peuvent peut-être penser que l’espace pur, le vide (vacuum), ou les trois dimensions sont également l’objet de la vue et du toucher. Mais, bien que nous ayons une très grande propension à penser que les idées d’extériorité et d’espace soient des objets immédiats de la vue, nous avons, pourtant, si je ne me trompe, clairement démontré dans les parties précédentes de cet Essai que c’est une simple illusion survenant d’une rapide et soudaine suggestion de l’imagination qui associe si étroitement l’idée de distance aux idées de la vue que nous sommes portés à penser qu’elle est elle-même, jusqu’à ce que la raison corrige cette erreur, un objet propre et immédiat de ce sens. 127 – Nous avons montré qu’il n’y a aucune idée abstraite de la figure, et qu’il nous est impossible, quelle que soit la précision de notre pensée, de concevoir une idée de l’étendue séparée de toutes les qualités visibles et tangibles, idée qui serait commune à la fois à la vue et au toucher. Il reste maintenant la question de savoir si les étendues, les figures et les mouvements particuliers perçus par la vue sont du même genre que les étendues, les figures et les mouvements particuliers perçus par le toucher. Afin de répondre à cette question, je vais m’aventurer à établir la proposition suivante : l’étendue, les figures et les mouvements perçus par la vue sont spécifiquement distincts des idées du toucher appelées par les mêmes noms, et il n’y a aucune chose, telle qu’une idée ou un genre d’idée, qui soit commune aux deux sens. Cette proposition peut, sans beaucoup de difficulté, être tirée de ce qui a été dit à plusieurs endroits de cet Essai. Mais parce qu’elle semble si éloignée des idées reçues et des opinions arrêtées de l’humanité, et parce qu’elle leur semble si contraire, je vais essayer de la démontrer plus particulièrement, et dans son ensemble, par les arguments suivants. 128 – Lorsque, en percevant une idée, je la range dans telle ou telle classe, c’est parce qu’elle est perçue de la même manière que les idées de la classe dans laquelle je la range, ou parce qu’elle a une ressemblance ou une conformité avec elles, ou parce qu’elle m’affecte de la même façon. Bref, elle ne doit pas être entièrement nouvelle, mais elle doit avoir quelque chose d’ancien que j’ai déjà perçu. Elle doit, dis-je, avoir au moins autant en commun avec les idées que j’ai connues et nommées auparavant, pour me pousser à lui donner le même nom que celles-ci. Mais on a reconnu, si je ne me trompe, qu’un aveugle de naissance ne penserait pas, lorsqu’il voit pour la première fois, que les choses qu’il perçoit sont de même nature que les objets du toucher, ou qu’elles ont quoi que ce soit en commun avec ceux-ci ; mais il penserait qu’elles sont un nouvel ensemble d’idées perçues d’une nouvelle manière, et entièrement différentes de tout ce qu’il avait jamais perçu auparavant. De sorte qu’il ne les appellerait pas par les mêmes noms, et qu’il ne les considèrerait pas comme étant de la même classe que tout ce qu’il avait connu jusque-là. 129 – Deuxièmement, tout le monde admet que la lumière et les couleurs constituent une classe ou une espèce entièrement différente des idées du toucher, et aucun homme ne dira, je suppose, qu’elles puissent se faire percevoir par ce sens. Mais il n’y a aucun autre objet immédiat de la vue, en dehors de la lumière et des couleurs. Il en résulte donc directement qu’il n’y a aucune idée commune aux deux sens. 130 – C’est une opinion qui prévaut, même parmi ceux qui ont le plus justement pensé et écrit sur nos idées, et sur les manières dont elles pénètrent dans l’entendement, que quelque chose de plus que la seule lumière et les seules couleurs, avec leurs variations, est perçu par la vue. M. Locke appelle la vue « le plus étendu de tous nos sens, celui qui achemine vers nos esprits les idées de lumière et de couleurs qui sont particulières à ce sens seulement, et aussi les idées fort différentes d’espace, de figure et de mouvement » (Essai concernant l’entendement humain, L. III, ch. 9, sect. 9). L’espace et la distance, nous l’avons montré, ne sont pas plus l’objet de la vue que celui de l’ouïe (voir section 46). Et quant à la figure et à l’étendue, je laisse tous ceux qui examineront calmement leurs propres idées claires et distinctes décider s’ils ont une idée quelconque, introduite immédiatement et proprement par la vue, autre que la lumière et les couleurs seules ; ou s’il leur est possible de concevoir dans leur esprit une idée abstraite et distincte de l’étendue de la figure visibles, indépendamment de toute couleur ; et s’ils peuvent concevoir, d’autre part, la couleur sans l’étendue visible. Pour ma part, je dois avouer que je ne suis pas capable d’atteindre une si grande finesse d’abstraction ; je ne vois rien d’autre, au sens strict, que la lumière et les couleurs, avec leurs diverses nuances et variations. Celui qui, en outre, perçoit aussi, par la vue, des idées fort différentes et fort distinctes d’elles, possède cette faculté à un degré plus parfait et plus vaste que celui auquel je peux prétendre. Il faut reconnaître que, par la médiation de la lumière et des couleurs, d’autres idées fort différentes sont suggérées à mon esprit ; mais elles le sont aussi par l’ouïe qui, en dehors des sons qui appartiennent en particulier à ce sens, suggère, par leur intermédiaire, non seulement l’espace, la figure et le mouvement, mais aussi toutes les autres idées, quelles qu’elles soient, qui peuvent être signifiées par des mots. 131 – Troisièmement, c’est, je pense, un axiome universellement reçu, que des quantités du même genre peuvent être additionnées, et former une somme entière. Les mathématiciens ajoutent des lignes à des lignes, mais ils n’ajoutent pas une ligne à un solide, ou ne la conçoivent pas comme formant une somme avec une surface. Ces trois genres de quantités étant considérées comme incapables d’être additionnées ensemble de cette manière, et, par conséquent, d’être comparées les unes avec les autres, selon les diverses méthodes de proportion, les mathématiciens estiment qu’elles sont totalement différentes et hétérogènes. Que chacun essaye, maintenant, d’ajouter, par la pensée, une ligne ou une surface visible à une ligne ou une surface tangible, de manière à les concevoir comme formant une somme ou un tout continu. Celui qui en est capable peut penser qu’elles sont homogènes ; mais celui qui n’en est pas capable doit, d’après l’axiome précédent, penser qu’elles sont hétérogènes. Je peux concevoir qu’une ligne bleue et une ligne rouge s’ajoutent l’une à l’autre en une somme, et qu’elles fassent une ligne continue ; mais faire, par la pensée, une ligne continue, en ajoutant l’une à l’autre une ligne visible et une ligne tangible c’est, je pense, une tâche beaucoup plus difficile, et même insurmontable ; et je laisse à la réflexion et à l’expérience de chacun en particulier de décider la question pour lui-même. 132 – Une plus ample confirmation de notre principe peut être tirée de la solution du problème de M. Molyneux que M. Locke a publié dans son Essai ; je vais présenter le problème, tel qu’il y est exposé, ainsi que l’opinion qu’en a M. Locke : « “Supposez un aveugle de naissance, maintenant adulte, qui a appris par le toucher à distinguer un cube d’une sphère du même métal et d’à peu près la même grosseur, de sorte qu’il puisse dire, lorsqu’il touche l’un et l’autre, lequel est le cube et lequel est la sphère. Supposez alors que le cube et la sphère soient placés sur une table, et que l’aveugle accède à la vue. On se demande si, par la vue, et avant de les avoir touchés, il pourrait maintenant distinguer et dire lequel est le globe et lequel est le cube.” A quoi le perspicace et judicieux auteur du problème répond : “Non. Car, bien qu’il ait acquis l’expérience de la manière dont un globe et un cube affectent son toucher, il n’a pourtant pas encore l’expérience que ce qui affecte son toucher de telle et telle manière doit affecter sa vue de telle et telle manière ; ou qu’un angle protubérant du cube, qui appuie sur sa main de manière inégale, apparaîtra, à son regard, tel qu’il apparaît en effet dans le cube.” Je m’accorde avec ce noble penseur, que je suis fier d’appeler mon ami, sur la réponse qu’il donne à son propre problème, et je crois que l’aveugle ne serait pas capable, la première fois qu’il voit, de dire avec certitude quel serait le globe et quel serait le cube, tant qu’il ne fait que les voir » (Essai concernant l’entendement humain, L. II, ch. 9, sect. 8). 133 – Or, si une surface carrée perçue par le toucher était de la même sorte qu’une surface carrée perçue par la vue, il est certain que l’aveugle mentionné ici pourrait reconnaître une surface carrée aussitôt qu’il la verrait : il ne s’agit de rien de plus que d’introduire dans son esprit, par une nouvelle voie, une idée qu’il connaissait déjà bien. Puisqu’il est donc censé avoir su, par le toucher, qu’un cube est un corps limité par des surfaces carrées, et si nous supposons qu’un carré visible et un carré tangible diffèrent seulement par le nombre, il s’ensuit qu’il pourrait savoir, par la marque infaillible des surfaces carrées, et tant qu’il ne faisait que les voir, quel serait le cube et quel ne le serait pas. Nous devons donc admettre, soit que l’étendue et les figures visibles sont spécifiquement distinctes de l’étendue et des figures tangibles, soit que la solution de ce problème, donnée par ces deux hommes profonds et ingénieux, est fausse. 134 – On pourrait rassembler beaucoup d’autres preuves de la proposition que j’ai avancée ; mais ce qui a été dit est, si je ne me trompe, suffisant pour convaincre quiconque y prêtera une attention raisonnable. Et quant à ceux qui ne se donneront pas la peine d’un petit effort de pensée, multiplier les paroles ne suffira jamais à leur faire comprendre la vérité, et à leur faire entendre exactement ce que je veux dire. 135 – Je ne peux pas abandonner le problème mentionné plus haut sans y réfléchir quelque peu. Nous avons montré qu’il est évident qu’un homme, aveugle depuis sa naissance, ne désignerait pas, à son premier regard, les choses qu’il verrait par les noms qu’il avait l’habitude d’appliquer aux idées du toucher (voir section 106). Cube, sphère, table sont des mots qu’il savait s’appliquer aux choses perceptibles par le toucher, mais dont il n’avait jamais su qu’ils s’appliquaient aux choses parfaitement intangibles. Ces mots, dans leur application habituelle, ont toujours désigné dans son esprit des corps ou des choses solides qui étaient perçus par la résistance qu’ils lui offraient. Mais il n’y a aucune solidité, aucune résistance ou aucune protubérance perçue par la vue. Bref, les idées perçues par la vue sont de toutes nouvelles perceptions auxquelles, dans son esprit, n’est joint aucun nom ; il ne peut donc pas comprendre ce qu’on lui dit à leur sujet. Et lui avoir demandé à propos des deux corps qu’il voyait placés sur la table lequel était la sphère et lequel était le cube, c’était pour lui une question parfaitement risible et inintelligible ; car rien de ce qu’il voyait n’était capable de suggérer à ses pensées l’idée d’un corps, d’une distance, ni, en général, d’aucune chose qu’il connût déjà. 136 – C’est une erreur de penser que la même chose affecte à la fois la vue et le toucher. Si le même angle, ou le même carré, qui est l’objet du toucher était aussi l’objet de la vision, qu’est-ce qui devrait empêcher l’aveugle de le connaître à son premier regard ? Car, bien que la manière dont l’objet affecte la vue soit différente de celle dont il affecte son toucher, comme, outre cette manière ou circonstance qui est nouvelle et inconnue, il y a l’angle ou la figure qui est ancienne et connue, il ne peut manquer de la discerner. 137 – Après avoir démontré que la figure et l’étendue visibles sont de nature entièrement hétérogène, et entièrement différente de la figure et de l’étendue tangibles, il nous reste à nous enquérir du mouvement. Or, il semble qu’il n’y ait pas besoin de prouver plus longuement que le mouvement visible n’est pas de la même sorte que le mouvement tangible, car c’est un corollaire évident de ce qui a été montré concernant la différence qu’il y a entre l’étendue visible et l’étendue tangible. Mais pour en donner une preuve plus complète et plus explicite, il nous suffira seulement d’observer qu’un homme qui n’aurait pas encore fait l’expérience de la vision ne pourrait pas, lorsqu’il voit pour la première fois, connaître le mouvement. D’où il suit clairement que le mouvement perceptible par la vue est d’une sorte distincte du mouvement perceptible par le toucher. Je prouve la proposition précédente de la manière suivante : cet homme ne pouvait connaître, par le toucher, aucun autre mouvement que celui qui se faisait vers le haut ou vers le bas, vers la droite ou vers la gauche, en s’approchant ou en s’éloignant de lui ; outre ces mouvements et leurs diverses variétés et compositions, il était impossible qu’il eût une idée quelconque du mouvement. Il ne considérerait donc pas comme mouvement, ni ne donnerait le nom de mouvement à une idée qu’il ne pourrait pas ranger dans l’un ou l’autre de ces genres particuliers de mouvement. Mais, d’après la section 95, il est clair que, par le simple acte de la vision, il ne pourrait pas connaître le mouvement vers le haut ou vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, ni dans aucune autre direction possible. J’en conclus qu’il ne connaîtrait pas le mouvement du tout la première fois qu’il voit. Quant à l’idée du mouvement pris abstraitement, je ne gaspillerai pas de papier à son sujet, mais je laisse au lecteur le soin d’en traiter du mieux qu’il peut. Pour moi, elle est parfaitement inintelligible. 138 – La considération du mouvement peut fournir un nouveau champ à l’investigation. Mais puisque la manière dont l’esprit appréhende par la vue le mouvement des objets tangibles peut être facilement tirée de ce qui a été dit à propos de la manière dont ce sens suggère les diverses distances, grandeurs et positions de ces objets, je ne m’étendrai pas plus longuement sur ce sujet ; mais j’en viens à considérer ce qui peut être allégué avec le plus d’apparence de raison contre la proposition dont nous avons montré la vérité. Car là où il y a tant de préjugés à affronter, une démonstration pure et simple de la vérité suffirait difficilement. Nous devons aussi satisfaire aux réticences que les hommes peuvent soulever en faveur de leurs notions préconçues, montrer d’où l’erreur surgit, comment elle en est venue à se répandre, et soigneusement découvrir et extirper ces fausses croyances qu’un ancien préjugé pourrait avoir implantées dans l’esprit. 139 – Premièrement, on se demandera donc comment l’étendue et les figures visibles en viennent à être appelées du même nom que l’étendue et les figures tangibles, si elles ne sont pas du même genre que celles-ci. Il doit y avoir quelque chose de plus que la fantaisie ou qu’un accident qui pût être l’occasion d’une coutume aussi constante et aussi universelle que celle-là, coutume qui a prévalu de tous les temps, dans tous les pays du monde et parmi les hommes de tout rang, parmi les doctes aussi bien que parmi les illettrés. 140 – A quoi je réponds que nous ne pouvons pas plus soutenir qu’un carré visible et un carré tangible sont de la même espèce, parce qu’ils sont appelés du même nom, que nous ne pouvons soutenir qu’un carré tangible et le mot composé de cinq lettres par lequel on le désigne sont de la même espèce parce qu’ils sont tous les deux appelés du même nom. Il est habituel d’appeler les mots écrits et les choses qu’ils signifient par le même nom, car les mots n’étant pas considérés dans leur nature propre, ni autrement que comme le signe des choses, il eût été superflu et en dehors des visées du langage de leur avoir donné des noms différents de ceux des choses qu’ils désignent. La même raison est valable ici aussi. Les figures visibles sont les marques des figures tangibles et, d’après la section 59, il est clair qu’elles ne sont guère considérées en elles-mêmes, ni à d’autre titre que pour leur connexion avec les figures tangibles qu’elles sont par nature destinées à signifier. Et parce que ce langage de la nature ne varie pas avec les différentes époques ou les différents pays, il en résulte qu’en tout temps et en tout lieu les figures visibles sont appelées par les mêmes noms que les figures tangibles respectives qu’elles suggèrent ; et ce n’est pas parce qu’elles leur ressemblent, ou parce qu’elles sont de la même sorte qu’elles. 141 – Mais, direz-vous, un carré tangible ressemble certainement plus à un carré visible qu’à un cercle visible. Il a quatre angles et autant de côtés ; et il en est de même pour le carré visible, alors que le cercle visible n’a rien de semblable, car il est limité par une seule courbe uniforme, sans lignes droites et sans angles, ce qui le rend inapte à représenter le carré tangible, mais très propre à représenter le cercle tangible. Il s’ensuit clairement que les figures visibles sont des motifs des figures tangibles respectives qu’elles représentent, ou sont de la même espèce ; il s’ensuit qu’elles leur sont semblables, et qu’elles sont aptes, par leur nature même, à les représenter puisqu’elles sont de la même sorte ; enfin il s’ensuit qu’elles ne sont à aucun égard des signes arbitraires, comme les mots. 142 – Je réponds qu’il faut reconnaître que le carré visible est plus apte que le cercle visible à représenter le carré tangible, mais ce n’est pas parce qu’il lui ressemble plus ou parce qu’il est davantage de la même espèce, mais c’est parce que le carré visible contient en lui plusieurs parties distinctes par lesquelles il représente les diverses parties distinctes correspondantes du carré tangible, alors que le cercle visible ne les contient pas. Le carré tangible a quatre côtés distincts et égaux, de même qu’il a quatre angles distincts et égaux. Il est donc nécessaire que la figure visible qui sera le plus propre à le représenter contienne quatre parties distinctes et égales correspondant aux quatre côtés du carré tangible ainsi que quatre autres parties distinctes et égales pour dénoter ainsi les quatre angles égaux du carré tangible. Et nous voyons, en effet, que les figures visibles contiennent en elles des parties visibles distinctes répondant aux parties tangibles distinctes qu’elles signifient ou qu’elles suggèrent. 143 – Mais il ne s’ensuivra pas qu’une figure visible quelconque est semblable à sa figure tangible correspondante, ou de même espèce qu’elle, à moins que l’on ne montre également que non seulement le nombre mais aussi le genre des parties sont les mêmes dans les deux figures. Pour illustrer ce point, je ferai observer que les figures visibles représentent les figures tangibles presque de la même manière que les mots écrits représentent les sons. Or, à cet égard, les mots ne sont pas arbitraires, car il n’est pas indifférent qu’un mot écrit désigne n’importe quel son. Mais il est indispensable que chaque mot contienne en lui autant de caractères distincts qu’il y a de variations dans le son qu’il désigne. Ainsi, la simple lettre « a » est propre à noter un simple son uniforme, et le mot adultère est fait pour représenter le son qui lui est associé ; et comme il se compose de huit différentes collisions ou modifications de l’air effectuées par les organes de la parole, chacune d’elles produisant une différence de son, il convenait que le mot qui les représente consistât en autant de caractères distincts, de manière à dénoter chaque différence particulière ou chaque partie de la totalité du son. Et pourtant personne ne dira, je suppose, que la simple lettre « a » ou que le mot adultère sont semblables aux sons respectifs qu’ils représentent ou de la même espèce qu’eux. Il est, en effet, arbitraire qu’en général les lettres d’un langage représentent des sons, mais, une fois convenu, il n’est pas arbitraire que telle combinaison de lettres représente tel ou tel son particulier. Je laisse au lecteur le soin de continuer ce raisonnement, et de l’appliquer à ses propres pensées. 144 – Il nous faut avouer que nous ne sommes pas aussi susceptibles de confondre les autres signes avec les choses signifiées, ou de les considérer comme de la même espèce, que nous sommes susceptibles de confondre les idées visibles avec les idées tangibles. Mais un petit examen nous montrera comment cela peut se faire sans que nous ayons à supposer qu’elles sont de même nature. Ces signes sont constants et universels ; leur connexion avec les idées tangibles a été apprise dès notre première venue au monde ; et depuis lors, elle s’est présentée à notre pensée à presque tous les moments de notre vie, s’est fixée et s’est attaquée plus profondément à notre esprit. Quand nous remarquons que les signes sont variables et d’institution humaine, quand nous nous souvenons qu’il y eut un temps où ils n’étaient pas associés dans notre esprit avec ces choses qu’ils nous suggèrent maintenant si facilement, mais où leur signification fut apprise par les lents progrès de l’expérience, cela nous préserve de les confondre. Mais lorsque nous pensons que les mêmes signes suggèrent les mêmes choses dans le monde entier, lorsque nous savons qu’ils ne sont pas d’institution humaine, et lorsque nous ne pouvons nous souvenir d’avoir jamais appris leur signification, mais que nous pensons qu’ils nous auraient suggéré, au premier regard, les mêmes choses qu’ils nous suggèrent maintenant, tout cela nous persuade qu’ils sont de la même espèce que les choses qu’ils représentent respectivement, et que c’est en vertu d’une ressemblance naturelle qu’ils les suggèrent à notre esprit. 145 – Ajoutez à cela que, toutes les fois que nous embrassons soigneusement du regard un objet quelconque en dirigeant successivement l’axe optique sur chacun de ses points, il y a certaines lignes et certaines figures, décrites par le mouvement de la tête ou des yeux, qui, bien qu’elles soient en réalité perçues par le toucher, se mêlent néanmoins tellement, pour ainsi dire, avec les idées de la vue que nous pouvons à peine penser qu’elles ne puissent pas appartenir à ce sens. En outre, les idées de la vue pénètrent, plusieurs à la fois, dans l’esprit d’une manière plus distincte et moins mélangée que celle qui est habituelle aux autres sens, en dehors du toucher. Les sons, par exemple, que l’on perçoit au même instant sont propres à se fondre, si je puis dire, en un seul son. Mais nous pouvons percevoir en même temps une grande variété d’objets visibles tout à fait séparés et distincts les uns des autres. Or, l’étendue tangible étant formée de plusieurs parties distinctes coexistantes, nous pouvons en tirer une autre raison qui peut nous porter à imaginer une ressemblance ou une analogie entre les objets immédiats de la vue et ceux du toucher. Mais rien, certainement, ne contribue plus à les mélanger et à les confondre que la connexion étroite et stricte qu’ils ont les uns avec les autres. Nous ne pouvons ouvrir les yeux sans que les idées de distance, de corps et de figures tangibles soient suggérées par les idées visibles. La transition des idées visibles aux idées tangibles est si rapide et si soudaine que nous pouvons difficilement nous abstenir de penser qu’elles sont toutes également l’objet immédiat de la vision. 146 – Le préjugé qui se fonde sur ces causes, quelles que soient les autres raisons qui puissent lui être assignées, adhère si rapidement à notre entendement qu’il est impossible de s’en débarrasser complètement sans un effort et un labeur obstinés de celui-ci. Mais la répugnance que nous avons à nous défaire d’une opinion ne peut pas être alors une preuve de sa vérité pour quiconque examine ce qui a déjà été montré sur les préjugés que nous nourrissons quant à la distance, à la grandeur et à la situation des objets — préjugés si familiers à nos esprits, si fermes et si enracinés, qu’ils laisseront difficilement place à la plus claire des démonstrations. 147 – En somme, je pense que nous pouvons conclure honnêtement que les objets propres de la vision constituent un langage universel de l’Auteur de la nature par lequel nous apprenons à régler nos actions en vue d’acquérir ces choses qui sont nécessaires à la préservation et au bien-être de nos corps, et aussi d’éviter tout ce qui peut leur nuire et les détruire. C’est principalement par les informations qu’ils nous donnent que nous sommes guidés dans toutes les affaires et dans toutes les occupations de la vie. Et la manière dont ils nous font entendre et dont ils nous indiquent les objets qui sont à distance, est la même que celle des langages et des signes de facture humaine qui ne suggèrent pas les choses signifiées par une ressemblance ou une identité de nature, mais seulement par une connexion habituelle que l’expérience nous a fait remarquer entre eux. 148 – Supposez qu’un homme qui serait toujours resté aveugle entende son guide lui dire qu’après s’être avancé de tant de pas il arrivera au bord d’un précipice ou qu’il sera arrêté par un mur ; cela ne doit-il pas lui sembler très admirable et très surprenant ? Il ne peut pas concevoir comment il est possible pour les mortels de faire de telles prédictions qui lui semblent aussi étranges et inexplicables que le sont les prophéties pour les autres. Même ceux qui ont le bonheur de jouir de la faculté visuelle peuvent (bien que la familiarité fasse qu’elle est moins remarquée) y trouver une cause suffisante d’admiration. L’art merveilleux et l’esprit d’invention avec lesquels la vue est adaptée aux fins et aux objets pour lesquels elle était manifestement conçue, l’étendue, le nombre et la variété immenses des objets qu’elle suggère d’un seul coup, avec tant de facilité, de rapidité et de plaisir, tout cela fournit matière à une longue et plaisante méditation, et peut, si tant est que ce soit possible, nous donner par analogie quelque vague prénotion des choses qui sont placées au-delà de ce que nous pouvons découvrir et comprendre dans notre état présent. 149 – Je n’ai pas l’intention de me tracasser à tirer les corollaires de la théorie que je viens d’établir. Si elle supporte la critique, d’autres peuvent, autant qu’ils le jugeront convenable, employer leurs pensées à la développer plus longuement, et à l’appliquer aux objets auxquels elle peut être utile. Cependant, je ne peux m’abstenir de faire quelque recherche sur l’objet de la géométrie, car le sujet dont nous nous sommes occupés y conduit naturellement. Nous avons montré qu’il n’y a rien de tel que l’idée d’étendue abstraite, et qu’il y a deux genres d’étendue et de figures sensibles qui sont entièrement distincts et hétérogènes l’un de l’autre. Il est donc naturel de rechercher lequel des deux est l’objet de la géométrie. 150 – Il y a plusieurs choses qui, à première vue, nous portent à penser que la géométrie s’occupe de l’étendue visible. L’usage constant des yeux dans les parties pratiques et théoriques de cette science nous entraîne fortement à le croire. Il semblerait sans doute étrange à un mathématicien que l’on essayât de le convaincre que les diagrammes aperçus par lui sur le papier ne sont pas les figures qui font l’objet de la géométrie, ou qu’ils ne leur sont pas même semblables. Car l’opinion contraire est tenue pour être une vérité indubitable non seulement par les mathématiciens, mais aussi par ceux qui s’appliquent plus particulièrement à l’étude de la logique, je veux dire ceux qui examinent la nature de la science, de la certitude et de la démonstration. Ils donnent, comme une des raisons de la clarté et de l’évidence extraordinaires de la géométrie, le fait que les raisonnements sont, dans cette science, libres de tous les inconvénients qui accompagnent l’utilisation des signes arbitraires, car les idées mêmes sont copiées et exposées à la vue sur le papier. Mais, soit dit en passant, comment cela peut bien s’accorder avec ce qu’ils avancent également, à savoir que les idées abstraites sont l’objet de la démonstration géométrique, je le laisse à considérer. 151 – Pour arriver à une solution sur ce point, nous n’avons qu’à attirer l’attention sur ce qui a été dit dans les sections 59, 60 et 61 où l’on a montré que les étendues visibles ne sont guère considérées en elles-mêmes, qu’elles n’ont aucune grandeur fixe et déterminée, et que, tout compte fait, les hommes mesurent en appliquant une étendue tangible sur une étendue tangible. Tout cela montre avec évidence que l’étendue et les figures visibles ne sont pas l’objet de la géométrie. 152 – Il est donc clair que les figures visibles ont en géométrie le même usage que les mots, et les uns comme les autres peuvent bien être compris comme l’objet de cette science, car ni les uns ni les autres ne s’y rapportent si ce n’est en tant qu’ils représentent ou suggèrent à l’esprit les figures tangibles particulières auxquelles ils sont associés. Il y a, il est vrai, cette différence entre la signification des figures tangibles par les figures visibles et celle des idées par les mots, que cette dernière est variable et incertaine car elle dépend tout à fait de la désignation arbitraire des hommes, tandis que la première est fixe, et immuablement la même en tout temps et en tout lieu. Un carré visible, par exemple, suggère à l’esprit la même figure tangible en Europe et en Amérique. C’est ainsi que la voix de l’Auteur de la nature, qui parle à nos yeux, n’est pas exposée à ces contresens et à cette ambiguïté auxquels les langages d’invention humaine sont immanquablement sujets. 153 – Bien que ce que l’on ait dit puisse suffire à montrer quelle solution il faut admettre relativement à l’objet de la géométrie, je vais néanmoins considérer, pour illustrer plus complètement ce point, le cas d’une intelligence ou d’un esprit sans corps qui, suppose-t-on, voit parfaitement bien, c’est-à-dire qui a une perception claire des objets propres et immédiats de la vue, mais qui est absolument privé du sens du toucher. Qu’il y ait ou non un tel être dans la nature n’est pas de mon propos. Il suffit que la supposition ne soit pas contradictoire en elle-même. Examinons maintenant quels progrès un tel être peut faire en géométrie. Cette spéculation nous amènera à voir plus clairement s’il se peut que les idées de la vue soient l’objet de cette science. 154 – Premièrement, donc, il est certain que l’intelligence dont je viens de parler ne pourrait avoir aucune idée d’un solide ou d’une quantité à trois dimensions, puisqu’elle n’a pas l’idée de distance. Nous sommes, en effet, enclins à penser que la vue nous donne les idées d’espace et de solide ; cela vient de ce que nous nous imaginons voir, strictement parlant, la distance et certaines parties d’un objet à une plus grande distance que les autres ; nous avons démontré que cela résulte de l’expérience que nous avons faite de la connexion de telles idées du toucher avec telles et telles idées accompagnant la vision. Mais l’intelligence dont il s’agit ici est supposée n’avoir aucune expérience du toucher. Elle ne jugerait donc pas comme nous le faisons, ni n’aurait aucune idée de la distance, de l’extériorité ou de la profondeur, et, par conséquent, de l’espace ou du corps, que ce soit immédiatement ou par suggestion. Il s’ensuit clairement qu’elle ne peut avoir aucune notion des parties de la géométrie qui concernent la mesure des solides — et de leurs surfaces convexes et concaves —, et qui envisagent les propriétés des lignes engendrées par la section d’un solide. Concevoir une quelconque de ces parties est hors de la portée de ses facultés. 155 – De plus, elle ne peut comprendre la manière dont les géomètres décrivent une ligne droite ou un cercle, car la règle et le compas, ainsi que leur utilisation, sont des choses dont il est impossible qu’elle puisse avoir quelque notion. Il ne lui est pas non plus facile de concevoir la superposition d’un plan ou d’un angle sur un autre plan ou sur un autre angle pour prouver leur égalité, puisque cela suppose quelque idée de distance ou d’espace extérieur. Tout cela montre avec évidence que notre pure intelligence ne pourrait arriver à connaître ne seraient-ce que les premiers éléments de la géométrie plane. Et l’on trouvera peut-être, par une recherche rigoureuse, qu’elle ne peut pas plus avoir une idée des figures planes qu’elle ne peut en avoir des solides, puisqu’une idée de la distance est nécessaire pour former l’idée d’un plan géométrique, comme il apparaîtra à quiconque réfléchira quelque peu sur la question. 156 – Tout ce qui est proprement perçu par la faculté visuelle se réduit aux seules couleurs, à leurs variations et aux différents degrés d’ombre et de lumière. Mais la mutabilité et la fugacité incessantes de ces objets immédiats de la vue les rendent incapables d’être arrangés à la manière des figures géométriques ; et il ne serait aucunement utile qu’ils le fussent. Il est vrai que nombre d’entre eux sont perçus simultanément, certains en plus grand nombre et d’autres en moins grand nombre ; mais calculer exactement leur grandeur, et attribuer des proportions précises et déterminées entre des choses si variables et si instables, à supposer que cela fût possible, ne saurait être qu’un travail très dérisoire et très insignifiant. 157 – Je dois avouer que les hommes sont tentés de penser que les figures plates ou planes sont les objets immédiats de la vue, bien qu’ils reconnaissent que les solides ne le sont pas. Et cette opinion est fondée sur ce que l’on observe en peinture où (semble-t-il) les idées immédiatement imprimées dans l’esprit ne sont que les idées de plans diversement colorés qui, par une opération soudaine du jugement, sont transformés en solides. Mais avec un peu d’attention, nous verrons que les plans mentionnés ici comme les objets immédiats de la vue, ne sont pas des plans visibles mais des plans tangibles. Car, lorsque nous disons que les tableaux sont des plans, nous voulons dire par là qu’ils paraissent lisses et unis au toucher. Mais alors cet aspect lisse et uni ou, autrement dit, cet aspect plan du tableau n’est pas perçu immédiatement par la vision, car il paraît varié et multiforme à l’œil. 158 – Nous pouvons conclure, d’après tout cela, que les plans ne sont pas plus que les solides l’objet immédiat de la vue. Ce que nous voyons, au sens strict, ce ne sont pas des solides, ni même des plans diversement colorés, mais c’est seulement une diversité de couleurs. Et certaines d’entre elles suggèrent à l’esprit des solides, et d’autres des figures planes, de la manière même dont l’expérience nous a fait constater leurs connexions les unes avec les autres. De sorte que nous voyons les plans de la même manière que les solides, car les uns et les autres sont également suggérés par les objets immédiats de la vue qui sont eux-mêmes ainsi nommés plans et solides. Mais, bien qu’ils soient appelés par les mêmes noms que les choses qu’ils désignent, ils sont néanmoins d’une nature entièrement différente, comme nous l’avons démontré.
159 – Ce qui a été dit est, si je ne me trompe, suffisant pour trancher
la question que nous nous sommes proposés d’examiner, et qui concerne la
capacité d’un pur esprit, tel que nous l’avons décrit, à connaître la
géométrie. Il ne nous est pas, en effet, facile d’entrer exactement dans
les pensées d’une telle intelligence, parce que nous ne pouvons pas,
sans de grandes peines, habilement séparer et démêler, dans notre
esprit, les objets propres de la vue de ceux du toucher qui leur sont
associés. Cela semble, en effet, au plus haut point, très difficile à
exécuter ; ce qui ne nous paraîtra pas étrange si nous remarquons
combien il est difficile à chacun d’entendre prononcer à ses oreilles
les mots de sa langue maternelle sans les comprendre. Bien qu’il
s’efforce de séparer le sens du son, celui-là s’imposera néanmoins à son
esprit, et il trouvera extrêmement difficile, sinon impossible, de se
mettre lui-même exactement dans la position d’un étranger qui n’a jamais
appris cette langue, de sorte qu’il est simplement affecté par les sons
eux-mêmes, et qu’il ne perçoit pas la signification qui leur est
attachée. Il est clair, à présent, je suppose, que ni l’étendue
abstraite ni l’étendue visible ne font l’objet de la géométrie ; et de
ne pas l’avoir discerné a peut-être créé quelque difficulté et quelque
peine inutile en mathématiques.
Notes
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
« Nous connaissons, en second lieu, la distance par le rapport qu’ont
les deux yeux l’un à l’autre. Car, comme notre aveugle, tenant les deux
bâtons AE, CE, dont je suppose qu’il ignore la longueur, et sachant
seulement l’intervalle qui est entre ses deux mains A et C, et la
grandeur des angles ACE, CAE, peut de là comme par une Géométrie
naturelle, connaître où est le point E ; ainsi quand nos deux yeux, RST
et rst, sont tournés vers X, la grandeur de la ligne Ss, et celle des
deux angles XSs et XsS, nous font savoir où est le point X.
Nous pouvons aussi le même par l’aide d’un œil seul, en lui faisant changer de place : comme si, le tenant tourné vers X, nous le mettons premièrement au point S et incontinent après au point s, cela suffira pour faire que la grandeur de la ligne Ss et des deux angles XSs et XsS se trouvent ensemble en notre fantaisie, et nous fassent apercevoir la distance du point X : et ce, par une action de la pensée, qui, n’étant qu’une imagination toute simple, ne laisse point d’envelopper en soi un raisonnement tout semblable à celui que font les arpenteurs, lorsque, par le moyen de deux différentes stations, ils mesurent les lieux inaccessibles. » Je pourrais, dans le même but, accumuler les citations de plusieurs auteurs, mais comme le propos est si clair, et comme il vient d’un auteur si éminent, je ne dérangerai pas le lecteur plus longuement. Ce que j’ai dit sur ce chapitre n’avait pas pour but de trouver des fautes chez les autres, mais, en premier lieu, de démontrer, parce que je le jugeais nécessaire, que nous ne voyons pas la distance immédiatement, ni même par la médiation de quelque chose (comme des lignes et des angles) qui lui est nécessairement associé. Car toute la théorie dépend de la démonstration de ce point. Deuxièmement, on m’objecte que l’explication que je donne sur l’apparence de la lune à l’horizon (et qui peut être aussi appliquée au soleil) est la même que celle que Gassendi a déjà donnée. Je réponds que mention est faite, en effet, de l’épaisseur de l’atmosphère dans les deux démonstrations, mais que, par ailleurs, les méthodes selon lesquelles ce point est appliqué pour expliquer le phénomène sont entièrement différentes, comme on pourra le voir avec évidence, si l’on compare ce que j’ai dit sur le sujet avec cette citation de Gassendi :
Troisièmement, on m’objecte, contre ce qui est dit à la section 80, qu’une même chose, qui est si petite qu’elle est à peine distinguée par un homme, peut apparaître comme une montagne à un petit insecte ; il s’ensuit que le minimum visible n’est pas égal pour toutes les créatures. Je réponds que, si cette opinion était sondée jusqu’aux fondements, on ne trouverait rien de plus que ceci : la même particule de matière qui, pour un homme, est figurée par un minimum visible, présente, pour un insecte, un grand nombre de minimums visibles. Mais cela ne prouve pas qu’un seul minimum visible de l’insecte n’est pas égal à un seul minimum visible de l’homme. Ne pas distinguer entre les objets médiats et les objets immédiats de la vue, c’est, je le crains, rendre ce sujet incompréhensible. On a fait d’autres contresens et provoqué d’autres difficultés, mais ils portent sur des points où je me suis efforcé d’être si clair que je ne vois pas comment je pourrais m’exprimer plus distinctement. Tout ce que j’ajouterai, c’est que, si seulement ceux qui se plaisent à critiquer mon essai en lisaient la totalité avec quelque attention, ils n’en pourraient que mieux comprendre la signification, et par conséquent, que mieux juger de mes erreurs. J’ai appris que, peu de temps après la première édition de ce traité, un homme, quelque part près de Londres, a accédé à la vue, un homme qui avait été aveugle depuis sa naissance, et qui l’était resté pendant environ vingt ans. On peut supposer qu’une telle personne soit un juge adéquat pour décider combien les quelques principes établis dans plusieurs endroits du précédent essai agréent à la vérité ; et si une personne curieuse a l’opportunité de lui poser les questions appropriées sur ce sujet, je verrai avec joie mes idées soit corrigées soit confirmées par l’expérience.
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
Édité en 2007 |
|||||||
|
précédent |
|
|
|||||
|
suivant |
|||||||
|
|
|
||||||
|
Lire aussi |
|||||||
| Téléologie ouverte | téléologie ouverte | |||
| Belles Emotions | troubles de l'ordre | |||
| observatoire de téléologie | turn over | |||
| Nous contacter | time out | |||